Dossier réalisé par Marina GRAESEL et Charlotte DA CUNHA – Master CMW Groupe 2
Le cinéma est né en 1895. On associe cette date anniversaire à la date de création du dispositif de “film”, inventé par des français bien connu de tous – les frères Lumière. Mais la notion de “cinéma” est plus complexe qu’elle n’en a l’air, et cette date ne représente qu’une étape sur les trois qui définissent le “cinéma” comme on l’entend aujourd’hui.
Après la création du cinématographe*, (dont le terme “cinéma” est l’abréviation) breveté le 13 février 1895 par les frères Lumière et la première projection publique des “vues cinématographiques”, résultats des tests de l’invention des deux frères, le 22 mars 1895, ce n’est que 10 ans plus tard que naissent les lieux dédiés à la projection de films : la salle Omnia Pathé, boulevard Montmartre à Paris, créée par la célèbre société Pathé et son équivalent aux États-Unis, avec les “nickelodeons”. C’est ainsi que naissent les premiers lieux dédiés au cinéma, qui standardisent la “séance de cinéma” comme on la connaît et on la consomme encore aujourd’hui : avec son programme, une heure précise de diffusion et une organisation hebdomadaire des séances.
Suite à l’invention du médium et l’ouverture de lieux dédiés, la troisième étape de la création du cinéma est associée à son élévation en tant qu’art à part entière. Jusqu’à cette troisième étape, le “septième art” n’était pas considéré comme tel. En effet, les frères Lumière ne se reconnaissaient pas comme des “artistes”, mais comme des inventeurs, industriels et scientifiques, cherchant à “saisir la nature sur le vif” en filmant le quotidien et ainsi “vaincre la mort” par la capture du “flux du vivant”. On est ici bien loin d’une expression artistique, et c’est peut être pour cette raison que le cinématographe et l’engouement qu’il avait suscité, notamment au cours de l’exposition universelle de 1900, ont fini par s’essouffler, comme l’avait prédit le père des deux frères : “Le cinématographe est sans avenir”.
Ce n’est qu’à partir des années 1910 que le cinéma commence à être perçu comme un art par une poignée d’individus, pour finalement s’imposer comme tel à partir des années 1930. Cette élévation a été permise, entre autre, par Ricciotto Canudo, critique italien et créateur du terme “septième art”. Dans plusieurs de ses écrits, et notamment Manifeste des sept arts (1923), Canudo décrit le cinéma comme l’art de la synthèse parfaite, qui comprend tous les arts visuels, et le place donc après les six arts “traditionnels” : l’architecture ; la sculpture ; la peinture et le dessin ; la musique ; la littérature ; la danse, le théâtre, le mime et le cirque. La création des “ciné-clubs”, terme créé par Louis Delluc, réalisateur, scénariste et critique de cinéma français né en 1890, contribuera à la reconnaissance finale accordée au cinéma. Les ciné-clubs avaient et ont toujours pour principe d’expliquer un film, que l’on diffuse par la suite et qui se termine par un débat entre le groupe d’individus passionnés ou non qui compose le club. Cette pratique a permis de recentrer l’attention sur un seul film à la fois, car à l’époque, plusieurs films, ou même les informations, étaient diffusés pendant une seule et même séance. Enfin, la mise en place de festivals dédiés, avec notamment le festival de Venise “Exposition d’art cinématographique” de 1932, achèvera d’imposer le cinéma comme un art, et plus seulement comme une industrie et un commerce.
Le cinéma a donc aujourd’hui 124 ans, et est reconnu comme “septième art” depuis environ 90 ans. Mais qu’en est-il de son histoire ? En effet, les scientifiques et chercheurs ne se sont que très tardivement tournés vers le cinéma et son histoire comme discipline et terrain de recherche à part entière de par sa reconnaissance tardive en tant qu’art. Ce n’est qu’à partir des années 1980 qu’un courant d’étude du cinéma comme objet d’histoire se développe, avec la création de l’AFRHC (Association Française de Recherche sur le Cinéma) en 1984 et l’avènement du champ historique français “histoire culturelle” dont l’un des pionniers est l’historien Pascal Ory.
Les premières sauvegardes et restaurations cinématographiques réalisées se sont inscrites dans ce mouvement et cet engouement scientifique, accompagnées d’une prise de conscience patrimoniale du cinéma. En effet, le cinéma permettant de reproduire, d’une certaine manière, le réel et se présentant comme témoin de notre histoire avec, pour ne donner qu’un exemple, les séquences capturées pendant la Seconde Guerre Mondiale, les acteurs du cinéma et les passionnés ont pris conscience de l’importance historique de ses séquences, et donc l’importance de les conserver et les restaurer pour les générations à venir. Mais les restaurations cinématographiques dès les toutes premières réalisées, ont engendrées de nombreux questionnements, notamment entre les acteurs qui collaborent sur ces restaurations (techniciens, historiens du cinéma, agents publics, ayants droits**…), mais aussi depuis l’arrivée du numérique dans le secteur, qui utilisait l’argentique et la photochimie jusqu’à lors pour restaurer les œuvres cinématographiques.
La restauration cinématographique par le numérique entraîne-t-elle des dérives ou représente-t-elle une plus value ?
Pour répondre à ce questionnement majeur, dans un premier temps, nous reviendrons sur l’histoire de la restauration cinématographique, afin de comprendre ses enjeux et ses fondements, puis nous chercherons à comprendre comment fonctionne la restauration numérique et ses avantages, à travers notamment trois entretiens que nous avons réalisés auprès de Dimitri Vezyroglou, Maître de conférences cinéma à l’université Paris 1, Chargé de cours en Master Cultures et Métiers du Web et enseignant à l’École du Louvre ; Marie Frappat, Maître de conférences en études cinématographiques à l’Université Paris Diderot et Béatrice de Pastre, directrice des collections du CNC (Centre National du Cinéma et de l’image animée) et directrice adjointe à la direction du patrimoine. Enfin, nous terminerons notre étude de la restauration numérique par les inconvénients majeurs qu’elle pose aujourd’hui.
Retour sur la restauration et la conservation cinématographique avant l’arrivée du numérique
Avant d’utiliser dans ses procédés le numérique, la restauration était argentique et photochimique. Les premières restaurations cinématographiques ont été réalisées à partir des années 1930, puis ont grandement évoluées dans les années 1960 et enfin ont connu la dernière évolution notable dans le milieu, dès la fin des années 1990, avec l’arrivée du numérique.
L’activité de restaurer des films comporte plusieurs aspects : techniques, scientifiques, historiques et esthétiques. La restauration intervient alors sur différents points du film, en partant d’une intervention sur la pellicule, en la reproduisant tout en prenant en compte les données chimiques, physiques et techniques des matériaux qui constituent le matériel de la pellicule, ainsi que les outils de reproduction. Mais la restauration intervient également à partir des connaissances amassées sur le film et son auteur, et des éléments narratifs identifiés sur les différentes versions du film disponibles.
Différents profils de professionnels travaillent et collaborent lors d’une restauration : les conservateurs, les archivistes, les techniciens, les ayants droits** et les historiens du cinéma. Mais la restauration, même avant l’arrivée du numérique, a connu plusieurs évolutions et plusieurs objectifs d’utilisation.
Les pionniers de la restauration des films dès les années 1930
Les premiers acteurs à s’être intéressé à la conservation, puis à la restauration cinématographique sont les cinémathèques. Créées dans les années 1930, par des passionnés du cinéma, elles ont pris à cœur de collecter et rassembler tous les films que les fondateurs des cinémathèques avaient aimés, avant qu’ils ne soient détruits par les industriels. En effet, à l’époque, aucun dispositif ne sauvegardait les films, et les industriels qui les possédaient les laissaient “s’autodétruire”, à cause de l’instabilité des matériaux qui constituent les pellicules (le nitrate majoritairement, extrêmement inflammable), ou encore les détruisaient tout simplement à cause du peu de rentabilité de l’exploitation de ceux-ci ou encore au moment du passage au cinéma parlant, en 1926 – 1927.
Les cinémathèques, suivant les pays, prennent alors des formes différentes : certaines dépendent directement d’instances étatiques, comme la National Film Library du British Film Insitute à Londres, et d’autres se structurent sous la forme de nouveaux départements des musées d’art déjà existants, comme le MoMa à New York. Enfin, d’autres cinémathèques sont issues d’initiatives privées, d’amateurs, de collectionneurs ou de cinéphiles, comme la Cinémathèque française d’Henri Langlois à Paris.
Les cinémathèques construisent alors leur activité autour de deux aspects : la conservation immatérielle, qui consiste à transmettre les films au public, en les projetant et les diffusant, ainsi qu’à réaliser de nouveaux tirages des films afin de les échanger et de les partager avec d’autres cinémathèques et ainsi développer leurs collections. Le second aspect de l’activité des cinémathèques concerne la conservation matérielle, qui a pour but de trouver les meilleures solutions de stockage des bobines et de tirer des contretypes*** des films sujets à des dégradations. Malheureusement, les transferts de films réalisés ont parfois conduit à la destruction totale des supports originaux. Mais le tirage de contretypes, cependant, constitue le premier pas dans la restauration cinématographique.
Entrent alors en scène les laboratoires et les techniciens, car les cinémathèques ne disposaient pas toutes des techniques et du matériel nécessaires à la conservation et à la restauration des films. Les laboratoires, jusqu’à cet instant, travaillaient majoritairement pour la production commerciale, soit en développant, tirant et montant des copies réservées à l’exploitation, soit en travaillant à la réalisation de tirages requérant une grande agilité et attention. Malheureusement, la qualité de l’image n’était pas toujours présente : les films en couleurs étaient dupliqués en noir et blanc, les poussières et les défauts du support d’origine étaient reproduits à l’identique, ce qui faisait perdre de la définition à l’image par exemple. Ces problèmes purement techniques, liés à l’outil argentique et photochimique, n’étaient pas la préoccupation principale des cinémathèques, car pour elles, à cet instant, le plus important était de conserver “l’histoire” du film, plutôt que son aspect visuel. Face à ses acteurs qui réalisaient et réalisent toujours aujourd’hui des tâches quotidiennes de conservation vis-à-vis des films, et plus rarement des restaurations, d’autres figures vont émerger et s’imposer comme les vrais premiers projets de restauration : Metropolis de Fritz Lang (1927) par Enno Patalas et Napoléon d’Abel Gance (1927) par Kevin Brownlow.

L’objectif d’Enno Patalas et de Kevin Brownlow était de retrouver le montage le plus complet possible, qui rétablirait la narration du film et son rythme. Pour rétablir ces films qui leur paraissaient mutilés, les deux hommes issus du monde du cinéma (le premier était critique et historien du cinéma, le second était collectionneur, monteur, cinéaste, documentariste et producteur) ont passé de nombreuses années à retrouver, récupérer et assembler des éléments de ces deux films. Toutefois, ils ne se souciaient pas de rechercher si d’autres versions des deux films existaient et s’ils n’étaient pas en train de contredire l’œuvre originale au final. Les deux hommes, connaissant bien les techniques de conservation et de restauration, n’ont pas hésité à manipuler, découper ou encore reconstruire les copies pour réaliser leur “reconstruction”, en préservant toutefois les originaux. Mais d’autres, dans cette même volonté de reconstruction – restauration, n’ont eu aucun scrupule à travailler directement sur les originaux, et ainsi détruire le film et son support original.
Deux camps s’affrontent alors : ceux qui veulent respecter l’œuvre originale, son montage et sa narration, et ceux qui veulent recréer toute la dimension “spectaculaire” du film, en apportant des modifications au montage et aux choix d’origine. Pour mieux comprendre cette tension entre les deux visions, prenons l’exemple du film Metropolis de Fritz Lang. Ce film a été restauré de nombreuses fois, par diverses personnes, dont Enno Patalas, comme nous l’avons vu plus tôt. Le musicien électro Giorgio Moroder, en a proposé une autre version raccourcie, colorisée, sonorisée et agrémentée de sous-titres en 1984 (nous reviendrons sur cet exemple plus précisément plus tard), alors que Enno Patalas a eu une démarche différente, qui ne changeait pas de l’esthétique initiale, celle de la version originale. Un même film, deux démarches et résultats radicalement différents. Mais au final, les deux démarches ne tentent pas de se rapprocher du film original, car dans un cas comme dans l’autre, les choix du créateur de l’œuvre ne sont pas respectés, tant dans l’aspect esthétique de l’image que dans le montage et la narration de l’histoire.
On constate que la restauration cinématographique, depuis ses débuts en 1930 à son évolution en deux camps distincts au cours des années 1970 – 1980, ne permet pas d’obtenir un objet, un résultat le plus proche possible du film tel qu’il a été vu à sa première sortie en salle, mais plutôt d’obtenir un nouvel objet, une nouvelle création permise par l’outil argentique, qui a énormément évolué entre temps (possibilité d’avoir du son – dialogues, musique et bruitages -, possibilité d’avoir une image en couleur et plus seulement noir et blanc, etc…).
La professionnalisation de la restauration dès les années 1980 – 1990
Alors que deux pratiques de la restauration cinématographique s’affrontent : le respect partiel de l’œuvre originale et la recréation d’une œuvre originale pour les goûts du public contemporain ; diverses réactions et actions se mettent en place, afin de professionnaliser la restauration cinématographique.
La Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF), née en 1938, développe des commissions, en réaction aux archivistes, conservateurs et cinémathèques qui petit à petit ont élaboré dans leur coin des règles de conduite de la restauration, jamais centralisées et propres à chaque établissement. La commission technique née alors en 1960, la commission catalogage en 1968 et la commission programmation et accès en 1991. Dès la fin des années 1980 et tout au long des années 1990, des archivistes et conservateurs commencent à élaborer des règles de restauration qui se veulent communes à tous les acteurs, tout en engageant des réflexions collectives sur une “éthique” de la restauration, pour tenter de l’encadrer. Par exemple, en 1986 à Canberra, pendant le congrès annuel de la FIAF, une des thématiques phares de l’événement était “Les problèmes techniques et éthiques de la restauration des films”.
Cependant, la FIAF ayant pour membre les institutions et donc les dirigeants de ces institutions ou encore certains services particuliers des cinémathèques, un grand nombre d’acteurs se retrouve donc “exclu” des réflexions et de la prise de décisions. Pour toucher d’autres typologies d’individus, des associations se forment : The Association of Moving Image Archivists prend forme en 1990, l’Association des cinémathèques européennes née en 1991 ou encore la Fédération des cinémathèques et archives de films en France en 1995.
Les actions menées par la FIAF et les associations se voient renforcer, notamment auprès du grand public, peut connaisseur du monde des films anciens, des films de patrimoines et des films restaurés, par l’arrivée de festivals dédiés aux questions de la conservation et de la restauration (la restauration représentant une branche particulière de la conservation cinématographique). Les “Journées du cinéma muet” de Pordenone naissent ainsi en 1982, et montrent au grand public des copies restaurées et conservées par les cinémathèques. Autre exemple marquant, le festival du “Cinema Ritrovato” de 1986, comme le spécifié Dimitri Vezyroglou, est un festival très apprécié du grand public, avec notamment un congrès sur les thèmes de la conservation, de la restauration et de la diffusion du patrimoine cinématographique, sujet qui passionne le grand public, à l’image des “Journées du patrimoine” et l’essor de ses fréquentations.
Face à toutes ces mesures prises par la FIAF, les associations et les festivals, les laboratoires commerciaux continuent à travailler sur diverses restaurations, mais les films anciens demandent des savoir-faire et des équipements particuliers et coûteux. Les films anciens sont sur des supports originaux fragiles, dégradés et sales, qui demandent des traitements particuliers dans les étapes d’essuyage, de tirage et de développement. Par rapport à des films “frais”, c’est-à-dire des films récents et tirés en série, les films anciens demandent des vérifications supplémentaires et des manipulations qui demandent une grande rigueur et de nombreuses précautions. Il faut tout d’abord nettoyer les champignons et moisissures présents sur la pellicule, réparer les perforations, les collures**** fragilisées, les déchirures et mesurer le retrait possible de la pellicule pour que les griffes des tireuses n’éclatent pas les perforations. Toutes ces étapes ne sont pas présentent dans la restauration et la copie de films “frais” et demandent du personnel qualifié et des techniques de plus en plus perfectionnées : le tirage par immersion, pour diminuer les rayures présentent sur le côté du support ; le Desmetcolor, qui permet de reproduire les couleurs des films muets, de façon très fidèle, alors qu’auparavant les films muets étaient conservés et copiés en noir et blanc, etc… Les laboratoires commerciaux, face à toutes ses techniques et ce personnel coûteux, ont pour la plupart fait le choix de ne plus travailler avec ses méthodes et ses machines, tandis que d’autres choisissent au contraire de se spécialisés dans le film ancien : le laboratoire hollandais Haghefilm en 1984, ou encore l’Immagine Ritrovata à Bologne, fondé en 1991, qui a formé treize personnes à travailler à la restauration, de la manière la plus fidèle, qui suit la déontologie discutée par tous les acteurs et les institutions du cinéma.
La démarche de formation du personnel mis en place par le laboratoire de l’Immagine Ritrovata va, à partir des années 1990, inspirer les responsables d’institutions. De nombreux programmes sont alors créés : l’école L. Jeffrey Selznick School of Film Preservation à Rochester en 1996 ou encore le programme « Archimedia » de l’Union Européenne. Toutes ses démarches, de certains laboratoires commerciaux et des institutions publiques, font naître une génération de professionnels de l’archivage, de la conservation et de la restauration, formés et sensibilisés aux nouveaux codes déontologiques (le « code d’éthique » rédigé par la FIAF en 1998) mais aussi à de nouvelles techniques. Mais ses nouveaux professionnels contribuent également à l’enrichissement des connaissances et techniques en alimentant le cinéma avec d’autres disciplines comme la philologie***** ou la restauration des peintures. Ces enrichissements ont permis d’adopter de nouvelles conventions, comme la systématisation de la documentation des restaurations par exemple.
Le monde du cinéma, et plus particulièrement le monde de la restauration a connu de nombreuses transformations. Des tâtonnements des débuts dans les années 1930, sur la bonne méthode à adopter pour restaurer les films et plus particulièrement les films anciens, en passant par les deux méthodes majeurs qui ont émergées et la professionnalisation des pratiques et des acteurs de la restauration, la restauration et la conservation cinématographique ont énormément évolué en l’espace de quelques dizaines d’années. Mais devant cette pratique encore jeune et fragile, qui voit encore ses acteurs avoir des démarches, des visions et des comportements différents, sans jamais trancher – les cinémathèques et leur volonté de préserver les films avant tout, et le monde de l’industrie, qui cherche à donner une seconde vie commerciale aux films – le numérique a engendré encore de nombreux changements et transformations dans ce secteur, qui en est encore à chercher ses codes et ses limites.
Les plus values de la restauration numérique
Le numérique au service d’une conservation et d’une restauration cinématographique publique
L’essor du numérique dans les années 1990 s’est progressivement imposé dans tous les domaines de notre société, notamment dans celui du cinéma. Ses nouvelles technologies ont permis de grandes avancées techniques, entre autres l’apparition d’une qualité d’image et de son en Haute Définition (HD), la possibilité d’intervenir sur l’image après le tournage, en post-production, et donc l’élaboration d’effets spéciaux. Mais elles permettent aussi de se séparer du support physique qu’est la pellicule au profit de fichiers immatériels, rendant alors la commercialisation et la diffusion des productions cinématographiques beaucoup plus facile. Peu à peu, quasiment toute la chaîne de production et de distribution s’est convertie au numérique, tant en outils de captation, de traitement des enregistrements, qu’en matériel de projection en salles.
Le phénomène s’est évidemment répandu au terrain du patrimoine cinématographique. Ces technologies apparaissent alors comme des solutions à certaines problématiques rencontrées par les institutions de conservation et de restauration liées à la sauvegarde des films anciens. En commençant par la dimension fragile de leur matérialité soumise à l’épreuve du temps, et même parfois à une grande inflammabilité. Ces objets deviennent alors dangereux mais aussi difficilement manipulables dans un désir de réparation et de transmission au public contemporain. Ils demandent donc d’être maniés avec une grande précaution et d’être entreposés dans des conditions spécifiques en termes de température et d’humidité. S’ajoute à cela la question d’espaces de stockages suffisamment grands pour conserver ces bobines dans la mesure où la production d’objets audiovisuels est conséquente et croissante. Le numérique semble répondre à cette peur de la perte du patrimoine cinématographique et aux interrogations liées à la capacité de le maintenir intact. L’État français, et plus largement l’Union Européenne, témoignent alors d’une réelle volonté de saisir les opportunités qu’offre ces nouvelles technologies en mettant en place différents dispositifs et subventions. Notamment dans le cadre du grand emprunt où est décrit un Dispositif d’Aide à la Numérisation des Films de Patrimoine (DANFP) qui a alloué une enveloppe de 750 millions d’euros en 2012 au CNC, dans l’objectif d’impulser les grands détenteurs de catalogues de films, soit les maisons de productions, à se rapprocher de cette figure étatique pour mener numérisations, restaurations et ré-exploitations des œuvres. Un accord fut même signé entre ces acteurs de l’industrie (Gaumond, Pathé, Studio Canal, etc.) et l’État, le 15 mai 2011, pendant le festival de Cannes spécifiant que ce dernier prendrait en charge 70% du budget des projets. D’autre part le CNC réserve aussi ses propres aides publiques à des objets cinématographiques déjà présentes dans ses collections (ses archives) ou alors appartenant à des ayants droits privés. Ces films ont une portée patrimoniale et artistique plus prononcée mais, ils sont moins connus et donc moins susceptibles de générer une rentabilité. C’est pourquoi l’institution peut alors régler jusqu’à 90% du montant du devis sous réserves de la décision d’une commission composée d’experts, tels que des techniciens, des diffuseurs ou encore des historiens du cinéma. Les films pris en charges sont choisis parmi la liste de demandes effectuées auprès de l’établissement en fonction, entre autres, de l’ancienneté du film, du nombre de copies existantes (d’exemplaires), de son apport historique et culturel, de l’engagement pris par le propriétaire ou l’ayant droit concernant la diffusion et l’accessibilité de l’objet ou encore, comme dit précédemment, de l’incertitude d’en générer du profit.
Et au delà des enjeux de conservation, en termes de gain de place et de protection des films, le numérique offre la possibilité d’intervenir sur l’image de façon plus profonde et plus précise pour effacer les défauts apposés par le temps sur la pellicule que la photochimie. En effet cette dernière ne permettait d’effacer les rayures et de nettoyer les poussières que de façon limitée. Et les nouvelles techniques digitales mettent à disposition des restaurateurs une “palette d’outils incroyable, […] incomparable avec ce que l’on avait auparavant quand on devait traiter matériellement, physiquement la pellicule.” selon Dimitri Vezyroglou. Il parle notamment de la restauration initiée par Studio Canal en 2012 de La Grande Illusion de Jean Renoir qui souffrait d’une très mauvaise qualité sonore : “il y a des moments où l’on entendaient pas très bien, la balance entre les dialogues et les musiques qui n’était pas bonne. Pour avoir vu la restauration, au moment où elle est sortie, c’était spectaculaire parce que l’on entendait le moindre mot du dialogue et on pouvait distinguer, la balance des sons était parfaite, le son était complètement nettoyé.”. Ces avancées ajoutent alors des étapes supplémentaires au processus de restauration. Après avoir vérifié l’état du support au niveau des collures, des perforations, mais aussi effectué des réparations directement sur le support, ainsi qu’enlever les poussières superficielles, la pellicule peut être ensuite scannée, image par image dans une résolution 2K, 4K ou encore 8K. Une fois le fichier numérique créé, il est alors possible d’effacer les imperfections liées à l’usure et donc de s’attaquer aux éclats de gélatine, aux poussières restantes éventuellement incrustée dans ce résidu pelliculaire, et ce jusqu’aux déchirures. Certains logiciels possèdent même une fonctionnalité permettant de supprimer ce type de défaut de façon automatique. Le technicien peut alors s’atteler à l’étape de l’étalonnage qui a pour objectif de restituer la colorimétrie de l’objet original, ainsi que la densité et les contrastes (des réglages concernant plus spécifiquement les films en noir et blanc). Ces avancées technologiques constituent de puissants outils pour sauver les films anciens de la dégradation et de la disparition. Et grâce à cela, il est encore possible de les diffuser au public contemporain, qui est bien présent comme en témoigne les nombreux festivals qui ont été érigés autour de ce thème tels que “Toute la mémoire du monde” qui se tient chaque année en mars à la Cinémathèque française de Paris, les “Giornate del cinema muto”, soit “Journées du cinéma muet” en français qui se déroulait à Pordenone, ou encore celui initié par la grande cinémathèque de Bologne “L’Immagine Ritrovata” ou “L’image retrouvée” depuis 1986. Et des sections spécifiques au patrimoine se sont même ouvertes dans de grands festivals plus connus, comme “Cannes Classiques” du festival de Cannes. Pour Dimitri Vezyroglou l’existence de ces manifestations culturelles sont l’expression d’une “passion pour le patrimoine qui s’est dégagée depuis une trentaine d’années environ, en France mais pas seulement”.

Le numérique comme protecteur de propriétés et d’héritages privés
Les techniques de conservation et de restauration numériques ne sont pas seulement profitables aux institutions. En effet, avant de faire partie d’un patrimoine territorial, les films anciens sont d’abord des créations de réalisateurs, qui eux aussi sont en proie à la peur de voir leurs œuvres se dégrader et disparaître. Le digital représente donc pour ces créateurs une grande opportunité de préserver leurs productions, ou de leur rendre lisibilité et éclat d’antan. Mais nous parlons ici d’objets datés, qui, pour la plupart, ont en réalité survécu aux personnes qui les ont créés. Ces pellicules représentent alors une partie d’eux-mêmes, qu’ils ont laissés derrière eux, une trace qui perdure après leur mort. Elles constituent pour leur famille et leurs descendants, un héritage porteur d’une forte valeur sentimentale. Ce patrimoine familial a donc une dimension très précieuse humainement parlant pour ces ayants droits. On peut aisément comprendre que ces héritiers soient animés par le désir de sauvegarder ces œuvres et de faire survivre d’une certaine façon leurs aînés. Mais ces individus peuvent se retrouver face aux mêmes problématiques que les institutions publiques, si ce n’est plus, dans la mesure où ils ne disposent ni des conditions et du savoir-faire nécessaire à la sauvegarde, ni du matériel que ces établissements possèdent. La dimension immatérielle du fichier numérique vient encore apporter des réponses à ces personnes, leur permettant de garder avec eux sous un autre format leurs bobines, sans acquérir d’équipement spécifiques ou de léguer en totalité leur héritage à un établissement spécialisé pour qu’il prenne en charge l’objet.
S’ajoutant à cela les dispositifs d’aides à la restauration numérique mis en place par l’État qui deviennent alors très pertinents et sont l’occasion pour ces ayants droits de profiter de la connaissance de spécialistes afin de réparer leurs pellicules avant d’en obtenir une copie non physique. Mais on constate que ces héritiers n’ont pas pour seule préoccupation de préserver leur patrimoine individuel, certains s’inscrivent et s’engagent dans une démarche importante de diffusion et de transmission. Béatrice de Pastre nous a notamment rapporté que Vera Clouzot, actrice et veuve du réalisateur d’Henri-Georges Clouzot, a coopéré avec Ghislaine Gracieux, une experte judiciaire en droits audiovisuels qui s’est spécialisée dans l’accompagnement des ayants droits, en permettant de remettre sur le marché les films dont elle est la détentrice pour l’anniversaire des 40 ans de la mort de son mari en 2017. Ils ont été rassemblés avec ceux appartenant à Studio Canal ou d’autres encore à TF1, et a résulté de cette collaboration entre ces différents acteurs, la valorisation d’une dizaine de productions de l’artiste. Des nouvelles exploitations qui se sont accompagnées d’une exposition à la Cinémathèque française, du livre Le mystère Clouzot de Noël Herpe, ou encore d’une rétrospective de l’ADRC (l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma). Tous ces évènements ont fait l’objet de plans de communication, ils ont attirés les journalistes, et furent l’occasion pour le public de découvrir ou de redécouvrir ces films et de transmettre un bout d’histoire du cinéma aux contemporains. Le numérique peut alors être perçu comme un facilitateur de transferts et d’accès au savoir, à la connaissance, à l’histoire cinématographique.
Le numérique comme outil de revalorisation d’œuvres oubliées détenues par l’industrie du cinéma
La conversion digitale du domaine du cinéma a aussi mené les grands acteurs actuels de cette industrie a commencé à considérer autrement leurs catalogues de fonds anciens. En effet, avant l’essor de ces technologies, la décomposition de la gélatine, le syndrome du vinaigre ou encore l’inflammabilité des pellicules, en somme l’effet du temps, n’étaient pas les seules causes de la disparition des films anciens. Les maisons de productions détruisaient ces objets, pour des raisons financières et commerciales. Elles sont avant tout des entreprises et leur but est de générer du profit avec les objets produits, leur mission est ainsi bien différente des institutions publiques. Alors lorsque des films tombaient en désuétude et se dégradaient jusqu’à ne plus être exploitables, il n’était pas envisageable de réaliser une restauration photochimique coûteuse pour simplement conserver une bobine sur une étagère. Cela représentait une perte d’argent, de temps et d’espace. Et donc du point de vue du marché il était logique de s’en débarrasser. Mais d’un point de vue historique et patrimonial cela est évidemment une grande perte, Marie Frappat parle alors d’une “destruction en masse des films”.
Mais le numérique change donc le regard porté par ces commerciaux sur leurs productions passées et offre la possibilité de leur donner une seconde vie d’un point de vue pécunier et de les exploiter à nouveau. Ce, grâce à des ressorties en salles par exemple, Béatrice de Pastre nous parle notamment de films dont “le box-office culmine à 30 000 – 40 000 entrées en salles, sur un an, un an et demi, ce qui est beaucoup par rapport à certains films neufs et frais qui sortent aujourd’hui, mais ce n’est pas non plus des millions d’entrées”. Mais il y a eu aussi le marché des VHS puis des Laser-Disc, des éditions DVD et désormais du Blu-Ray, mais qui restent des ventes assez aléatoires et instables. À cela s’ajoute également l’apparition de la VOD, mais qui, selon la directrice des collections du CNC, n’est pas pour l’instant “un modèle économique probant” au niveau des films de patrimoine. Cela permet tout de même aux industriels d’enregistrer quelques rentes à petite échelle. Mais ce qui a surtout relancé ces acteurs à donner de l’attention et à réinvestir dans les films anciens est l’apparition de la télévision. Alors que les salles de cinéma sont avant tout le lieu de lancement et de découverte de nouveaux films, la télévision, présente dans quasiment tous les ménages français désormais, devient un espace de rediffusion, et est animé par le besoin grandissant de remplir ses grilles de programmes. La télédiffusion est donc devenue l’opportunité de diffuser à nouveau ces productions audiovisuelles mais aussi la plus grosse source de revenus financiers pour ce type de films. Dimitri Vezyroglou évoque le montant de 6 000 euros pour trois passages sur la chaîne Ciné +, et 80 000 euros pour le même nombre de télétransmission sur Arte. L’entretien avec Béatrice de Pastre complète ces informations en ces mots : “La case Arte du lundi soir fonctionne bien, voir très très bien, avec plus d’un million de téléspectateurs et puis vous avez toutes les chaînes du câble, 6ter, Gulli, etc… qui font du film de patrimoine et à qui on ne pense pas […] il y a effectivement des ventes télé et pour un ayant droit c’est un apport important.”. L’industrie du cinéma puise donc à nouveau au fond de leurs catalogues pour exploiter ces œuvres laissées de côté, qui étaient destinées à l’oubli, pour les proposer à la télévision. Et pour certaines, celles avec le plus fort pourcentage de rentabilité, elles peuvent donc initier des ressorties en salles, éditions Blu-Ray, etc.
Mais il est tout de même à noter que ces rentes sont très relatives et ne sont en réalité possibles que grâce aux aides de l’État et de l’action du CNC. En effet avant de penser à la ré-exploitation de ces productions, il faut procéder à la transformation du support en fichier numérique. La numérisation d’une copie en bon état coûte entre 20 000 et 50 000 euros. Mais il est souvent nécessaire d’effectuer une restauration également, et le montant total de cette opération peut varier entre 80 000 euros et 200 000 euros. C’est le CNC qui permet à l’industrie du cinéma de percevoir des bénéfices en couvrant 70% de la facture des projets. Le numérique favorise donc une approche collaborative entre les différents ayants droits et les institutions publiques, comme pour le cas d’Henri-Georges Clouzot. Ces nouvelles techniques permettant de valoriser des productions oubliées afin qu’elles puissent rencontrées une audience friande du patrimoine, comme les experts ou les cinéphiles qui se rendent aux festivals spécialisés, le spectateur curieux et néophyte d’Arte, jusqu’au grand public, aux nouvelles générations, qui regardent diverses chaînes et qui se retrouvent héritiers de cette histoire.
Les dérives de la restauration numérique
Instabilité des outils numériques et mise en péril de l’éthique et de la déontologie de la restauration
Même si les acteurs du patrimoine s’accordent à dire que les dernières avancées technologiques apportent des outils très performants en termes de conservation et de restauration, ils restent très méfiants à leur égard car ils ne sont pas sans défauts. Et contrairement à la croyance commune que le numérique donnerait une réelle pérennité aux œuvres, il ne résout en réalité pas toutes les problématiques de sauvegarde. Tout d’abord on se rend compte que les fichiers digitaux ne sont pas plus stables que les bobines. Même si leur nature est immatérielle ils sont nécessairement stockés dans des supports physiques qui restent en proie aux effets du temps mais aussi à des dysfonctionnements. Dimitri Vezyroglou rappelle qu’un DVD a une durée de vie moyenne de 20 à 30 ans à peu près et que pour un disque dur, celle-ci s’élève à 5 ans. Dans le cas des instances d’archives, il s’agit de serveurs, soit “de disques durs géants qui font plusieurs pétaoctet de capacité”, qui ont pour rôle de conserver “des milliers de titres”, et ces machines nécessitent un entretien, une surveillance, des remplacements, de l’énergie et de la place. Marie Frappat indique dans son article que cela fait rentrer un nouveau professionnel dans la chaîne de la restauration qui est l’administrateur réseau. Celui-ci est en charge du bon fonctionnement de ces équipements complexes, les techniciens de conservation ne possédant pas la connaissance nécessaire pour cette mission. On observe alors finalement une complexification de la sauvegarde, ainsi que des coûts financiers et humains supplémentaires. À cela s’ajoute d’autres instabilités techniques, comme les formats de lecture qui évoluent, ainsi que les logiciels. Nécessitant alors de se rééquiper régulièrement, de vérifier la compatibilité des fichiers ou de les convertir. À savoir que ces manipulations peuvent aboutir à de la perte de pixels ou même de la corruption de données. Ce type de matériel paraît alors peu fiables, et même moins que les pellicules. Marie Frappat estime qu’en termes de sauvegarde des supports nitrate “on se rend compte que quand ils sont bien conservés et qu’ils ont été bien traités pendant toute leur histoire, etc, certes, certains se décomposent, mais dans l’ensemble on peut continuer de les conserver en l’état. Les films Lumière par exemple, les originaux existent toujours 120 ans après”. Et Dimitri Vezyroglou affirme que le support polyester, qui a succédé au nitrate et au triacétate, est “ininflammable mais en plus il résiste à l’épreuve du temps et on lui estime, dans des conditions évidemment de conservation, d’hygrométrie, température optimale, […] une durée de vie entre 300 et 500 ans”.
Au delà des propriétés de pérennité plus importantes par rapport au numérique, qui sont ici accordées aux pellicules, on retrouve un attachement particulier à ce type de support de par leur caractère initial et originel qui est porteur d’indices, de preuves de l’histoire du film permettant de comprendre les processus de sa création, du rythme du montage ou encore des techniques de trucages utilisés par le réalisateur à l’époque. Elles sont les témoins du passé cinématographique et sont ainsi très précieuses aux yeux des experts et des cinéphiles. Marie Frappat parle d’un “retour un petit peu du fétichisme de la pellicule et le tirage d’une copie film”, ainsi elle évoque des manifestations autour de cet objet comme des projections de certaines restaurations de Max Ophüls, qui sont ressorties sur pellicule en salles parisiennes. Elle mentionne également un festival où elle aimerait se rendre qui se déroule à Rochester, à la Georges Eastman House, spécialisé dans la diffusion de pellicules nitrate, une pratique interdite en France de par l’inflammabilité des supports. Mais qui donne accès à ce qu’elle appelle “la copie la plus pure”, et elle considère par ailleurs qu’en cas de restauration numérique, de toute façon, “on a à faire à un objet totalement transformé”. Pour elle le transfert digital induit automatiquement un changement de nature, l’objet n’est plus le même. De la même façon, Dimitri Vezyroglou évoque l’impossibilité actuelle de transférer parfaitement la balance des couleurs argentiques en numérique aboutissant à un décalage. Il affirme que ces types de différences sont “des choses qui, du point de vue du spectateur ordinaire, ne saute pas aux yeux, mais en réalité, il se passe toujours une sorte de mini-trahison de l’objet initial”.
Mais au delà de cette dimension fétichiste, ce fort intérêt pour l’objet pelliculaire se justifie par des cas de transformations beaucoup plus majeures qu’un léger décalage de colorimétrie lié à une incapacité technique. Nombreux sont les ayants droits ou propriétaires, autres que les institutions publiques, qui coupent des scènes, en ajoutent d’autres qui n’avaient pas été intégrées dans le montage initial, reconstruisent des images ou s’adonnent à des modernisations en termes de colorisation, de sonorisation, etc. Cela crée alors de nombreux désaccords entre les différentes parties d’un projet de restauration et sur le traitement des films anciens. Le CNC se retrouve à négocier avec les détenteurs des œuvres lorsque ces derniers veulent les modifier parce qu’aucune loi n’encadre directement le processus de restauration à proprement parler. C’est donc le Code de la propriété intellectuelle qui s’applique, même s’il n’est pas adapté aux œuvres de patrimoine, et donc le propriétaire de l’objet peut en faire ce qu’il souhaite. Seuls des principes éthiques et déontologiques ont été établis dans le milieu des archives, diffusés par la FIAF (comme nous l’avons vu plus tôt), mais ne représentent aucunement une autorité judiciaire, et n’a donc aucun pouvoir face à la propriété intellectuelle. Béatrice décrit alors la ligne de conduite du CNC de cette façon : “Nous, on est attachés à restituer l’œuvre telle que le spectateur l’a découvert en salle quand il est sorti la première fois”, et ajoute un peu plus tard lors de notre entretien : “À partir du moment où il y a ce respect du travail, de la culture et de la technologie qui a donné lieu à cette œuvre, la restauration est réussie. À partir du moment où vous fabriquez quelque chose qui devient incompréhensible, pour le spectateur, pour l’historien, alors là, c’est raté. C’est raté, c’est dangereux, parce que vous effacez toute possibilité de compréhension du film pour les générations à venir. Puisque le matériel d’origine il va quand même disparaitre un jour ou l’autre”. Elle s’inscrit ainsi dans une démarche respectueuse et historique, le CNC s’engage à ne pas trahir le caractère de reproductibilité et d’indicialité****** du cinéma. Ce sont donc pour des raisons de pérennité et de conservation de l’objet original que l’institution préfère les supports physiques au numérique et produit des retours sur pellicule dès qu’il arrive à convaincre le propriétaire ou l’ayant droit d’inclure cette étape dans le processus et donc dans le budget alloué à la restauration.
Quand les auteurs confondent restauration numérique et nouvelle version
Une des figures problématiques des détenteurs de droits pour les institutions publiques sont les créateurs, les propriétaires initiaux des œuvres. Dans son article, Marie Frappat écrit : “La participation des réalisateurs eux-mêmes est en général très risquée, car ceux-ci veulent presque toujours en profiter pour refaire et améliorer leur œuvre”. Et lors de notre entretien, elle a également abordé ce sujet : “les films récents, quand les auteurs sont encore en vie, ressortent aussi très souvent sous le label restauration, mais en fait ce sont des remontages, ou des nouvelles versions du film, […]. C’est normal, si vous relisez des choses que vous avez écrites il y a 5 ans, vous allez trouvez que telle ou telle phrase était pas bien écrite, etc, que votre paragraphe il irait mieux là, que votre paragraphe il est trop long, ben là c’est pareil”. Quant à Béatrice de Pastre, elle nous rapporte une de ses lectures sur ce thème : ”j’ai lu récemment une interview de Rappeneau, qui suite à la restauration financé par le CNC de Cyrano de Bergerac on lui dit : “Et pour vous, quel est l’intérêt de restaurer vos films ?” et il dit “Pour revoir le montage”, c’est pas fait pour ça une restauration”. Il apparaît alors que ce type de projet représente pour ces auteurs l’occasion de rééditer leurs œuvres en les modifiant, que ce soit pour faire disparaître des défauts, des oublis qu’ils n’avaient pas perçus lors de leur production. Mais aussi pour revoir le montage ou encore insérer des effets qu’ils voulaient produire mais que les techniques de l’époque ne permettaient pas.
Cette volonté des réalisateurs de profiter d’une restauration pour intervenir sur les éléments qui leur provoque insatisfaction est confirmée par Luciano Berriatua, réalisateur, historien du cinéma et restaurateur de films, lors de son intervention à la journée de rencontre du festival “Toute la mémoire du monde”. Il ouvre sa prise de parole ainsi : “Restaurer c’est pas la même chose pour les ayants droits et pour les archives. Par exemple, moi je suis un metteur en scène et j’ai des films que j’ai tourné et que l’on doit restaurer, parce que ils ont vieillis et les couleurs deviennent rouges dans les copies, etc. Mais qui va faire ça ? L’archive. Alors, l’éthique de l’archive doit imposé de ne rien toucher au film tel qu’il est sorti dans les salles, ça c’est l’éthique véritable. Mais, mon éthique c’est la contradiction totale, parce qu’en partie je travaille dans les archives et en partie je suis metteur en scène. Et je veux changer beaucoup de choses parce que je ne suis pas très content de ce que j’ai fais à l’époque. Alors c’est la schizophrénie totale. Qu’est-ce que je peux faire ? […] Les archives ne doit jamais me laisser restaurer mes films. Parce que la partie mauvaise de moi va sortir pour faire un autre film. Alors c’est le problème principal pour moi de la restauration. Parce qu’il y a deux restaurations différentes. La restauration des ayants droits, la maison de production, et la restauration de patrimoine, des archives. La responsabilité est très différente”. Par la suite, il compare le cinéma à l’archéologie en tant que témoin de l’histoire que l’on doit préserver pour permettre aux générations futures de comprendre les techniques de l’époque. Ici Luciano Berriatua reconnaît que les auteurs veulent se saisir de ces opportunités pour créer une nouvelle version du film, et il incombe aux institutions publiques de s’opposer aux demandes de trahison de l’œuvre.
Le poste de Béatrice de Pastre l’inclut dans le processus des restaurations, et elle est en contact direct avec les personnes initiant ces projets. Elle a donc plusieurs anecdotes de conflits rencontrés, dont une qu’elle nous a partagé concernant une restauration effectuée en numérique. Celle du Le Joli Mai de Chris Marker et de Pierre Lhomme, où déjà lors de la restauration photochimique de 2009 le premier des deux réalisateurs avait exigé de supprimer 14 minutes de séquence. Une deuxième en numérique a été effectuée par la suite en 2012 et, Chris Marker étant décédé, c’est Pierre Lhomme qui a énoncé seul ses souhaits quant au projet. Cette fois-ci encore, a été demandé une coupe de 7 minutes. Et la directrice des collections a dû entamer un travail de négociation : ”Donc là on a discuté, minute à minute, séquence par séquence, voilà et on est arrivé à une coupe de 4 minutes et quelques sur laquelle il ne voulait pas céder”. Elle s’est faite représentante et protectrice de l’œuvre, comme Luciano Berriatua le recommande mais elle ne possède malheureusement pas les droits, et de ce fait elle nous avoue : “on discute toujours, après y en a un qui doit céder. C’est plus souvent nous, parce qu’effectivement, nous ne sommes pas les auteurs ou les représentants des auteurs”. Ces effacements sont compliqués à accepter en particulier dans ce cas où il s’agit d’un film de 1962 sur la France “avec une richesse documentaire extrêmement forte, et tout un aspect politique, parce que c’est juste à la fin de la guerre d’Algérie” pour Dimitri Vezyroglou.
Ainsi les principes éthiques et déontologiques ne sont pas toujours respectés de par des motivations qui divergent entre les différentes parties d’un projet de restauration, cela complexifient leurs échanges, leurs rapports et le travail collaboratif. Les possibilités qu’offrent le numérique sont très tentantes pour les créateurs, et accentue leur envie d’améliorer leur travail aux risques de travestir l’histoire.
La restauration numérique au service de la rentabilité de l’industrie du cinéma
Le numérique a également fait entrer en mutation l’industrie du cinéma, mais pas seulement en termes d’équipements et de revalorisation d’œuvres qu’elle vouait à la destruction. Tout d’abord les laboratoires photochimiques se sont retrouvés démunis face à cette transition abrupte. Marie Frappat nous en rappelle les conséquences : ”il faut imaginer que les laboratoires tiraient quotidiennement des milliers et milliers de mètres de pellicules et il y a eu une énorme crise, toute la chaîne de diffusion des films a été convertie au numérique, il y avait plus de raison de tirer de pellicules, donc il y a eu de grands plans de licenciements de laboratoires”. Et Marie Frappat perçoit alors le Dispositif d’Aide à la Numérisation des Films de Patrimoine comme un soutien de l’État envers ses structures, afin qu’elles puissent continuer de travailler le temps qu’elles s’adaptent à ce tournant qui inclut de nouveaux équipements en termes de machines et de logiciels, mais aussi un nouveau savoir-faire à apprendre. L’historienne nous affirme également que l’introduction du digital dans ces établissements privés fait accroître le risque de trahisons des œuvres. En cause, le type de relation qu’ils entretiennent : il s’agit ici d’un client, d’un commanditaire qui s’adresse à un prestataire. “Les laboratoires ils sont plutôt là pour exécuter, ils font des devis”, et leur objectif est commercial. La déontologie qui est diffusée dans le milieu cinématographique a ici une valeur encore plus faible sans le symbole de l’État. Elle nous a énoncé quelques unes de ces règles, notamment : “le grand principe qui est diffusé […] dans le milieu des archives de films, en fait c’est de dire systématiquement ce qui a été fait sur la restauration comme dans le domaine de l’art, mais c’est un grand principe qui est, comment dire, qui est pas forcément appliqué […] déjà dans le domaine des cinémathèques et archives de films, […] mais alors dès qu’on en sort il l’est encore moins”. Elle nous mentionne également un autre protocole, celui de “la réversibilité, c’est à dire que si vous touchez à un film, si vous faites la restauration d’un film, il faut être sûr que l’on pourra revenir en arrière. Les techniques dans 10 ans auront évoluées, les personnes auront évoluées, les connaissances auront évoluées, on trouvera peut-être une autre copie”. Dimitri Vezyroglou apporte encore plus de doutes quant au respect des bonnes pratiques de restauration : “beaucoup de restaurateurs aujourd’hui, depuis le passage au numérique ont pour réflexe, quand ils ont une copie à restaurer, une copie en mauvaise état pour une raison ou pour une autre, c’est d’abord on fait un scan, et puis après on travaille sur le fichier numérique, avec tous les outils numériques”. Enfin Marie Frappat nous rappelle aussi que ces nouvelles technologies “ont été à la base conçus pour la post-production en fait, pour les effets spéciaux, ce genre de choses, et ces outils ont été donc appliqués à la restauration”. La directrice du CNC émet par ailleurs des critiques sur les fonctionnalités de ces logiciels, notamment celle qui permet d’effacer de façon automatique les imperfections, telles que les rayures et les poussières, qui peut causer également des pertes d’éléments visuels qui font partie intégrante du film et nécessite un contrôle de la part du technicien en charge. Une vérification qui n’a pas été effectuée par exemple pour des flocons de neige qui ont disparus de la version restaurée Les parapluies de Cherbourg. Leur utilisation favorise des comportements qui mettent en péril le respect des différents principes et la préservation des originaux.
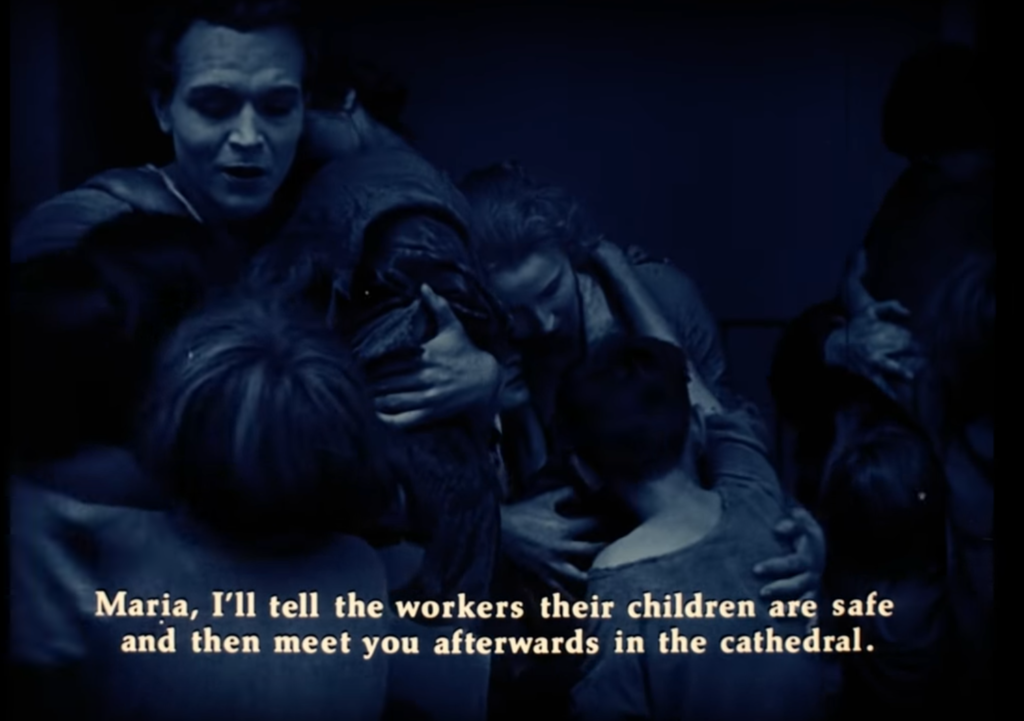
Plusieurs cas de restauration témoignent d’un respect de l’œuvre et de son histoire mis de côté au profit d’une modernisation ou d’une simplification de l’objet dans l’objectif de l’adapter en fonction des goûts contemporains et de le rendre plus accessible au public. Le cas le plus éloquent est celui de Metropolis réalisé par Fritz Lang et restauré par Giorgio Moroder en 1984, que Marie Frappat nous a mis en lumière. Celui-ci a apporté beaucoup de modifications au film original, muet et en noir et blanc. Tout d’abord il l’a colorisé et sonorisé, avec des morceaux de musiques électroniques contemporaines. Mais il a aussi supprimé les inter-titres qu’il a remplacé par des sous-titres, et il a même ajouté des titres séquentiels de sa propre création. Il a modifié le rythme du montage, créé un effet de brouillard sur une des scènes, et a éliminé en tout plus de 260 mètres de prises de vues. Marie Frappat affirme alors que “ça a fait scandale dans le domaine des cinémathèques, ça a été en même temps un énorme succès public”, et en effet ici on ne peut plus réellement parler de restauration, mais plutôt d’une reprise, d’une réinterprétation, et elle a été diffusée à grande échelle : à Paris elle est restée 6 mois à l’affiche en salles, et au Japon elle aurait généré 300 000 dollars en seulement 9 jours. Cette large diffusion de cette nouvelle version, appelée par défaut restauration, est effectivement très problématique de par de nombreux anachronismes techniques et esthétiques qui peuvent être assimilés comme faisant partie de l’original de 1927 par les spectateurs, et cela produit un dysfonctionnement dans la transmission de l’histoire. Un autre exemple qui a remué le milieu des archives est celui de la restauration de Serge Bromberg, directeur de la maison de production Lobster, du Voyage dans la Lune, réalisé initialement par George Méliès en 1902. Ce projet a été mené à partir d’un morceau d’une copie couleur trouvée en Espagne, cette portion a servi à la colorisation de tout le film et a été présentée par Lobster comme “la version originale en couleur”, comme indiqué dans leur communiqué de presse. Or d’autres versions couleurs ont été produites avant celle-ci, en effet chaque film était colorisé à la demande et à la main par plusieurs coloristes, les couleurs différaient donc entre chaque exemplaire. Autre élément problématique : les drapeaux de cette copie faisaient figurer des drapeaux espagnols et lors de sa restauration ceux-ci ont été modifiés en drapeaux français. Marie Frappat parle alors ici de “simplification de discours”, et nous avons à la fois une trahison de l’objet et un mensonge porté au public. Lors de son intervention à festival “Toute la mémoire du monde”, Luciano Berriatua avait aussi mentionné ce type de communication mensongère dans son discours, en disant qu’un travail de reconstitution était un vrai travail de recherche mais qu’il était nécessaire, en cas de modification de l’œuvre, de l’indiquer.
À cela s’ajoutent d’autres actes de la part du secteur de l’industrie du cinéma qui démontrent peu d’investissement dans la conservation des oeuvres. Dimitri Vezyroglou nous informe que dans le cadre du dépôt légal mis en place en 1977, il est exigé que tout film diffusé en France doit faire l’objet d’un dépôt d’une copie auprès du CNC. Or les producteurs préfèrent donner des DCP (Digital Cinema Package), soit des petits disques durs contenant le film en question, au lieu de tirer une copie sur support physique, parce que cela coûte moins cher à produire. Mais il faut rappeler que les fichiers numériques ont une pérennité bien inférieure aux pellicules polyester et que cela continue de compliquer les conditions de sauvegarde pour l’institution publique. De plus il arrive également que, pendant et après le processus même d’une restauration d’un objet cinématographique, soit ordonné l’interdiction de diffuser d’autres copies. Marie Frappat qualifie alors cette pratique d’ “embargo” et l’explique par les visées commerciales des maisons de productions. C’est le cas de Studio Canal qui n’autorise que la projection de sa version restaurée de La Grande Illusion de Jean Renoir.
En effet même si le numérique a permis à l’industrie du cinéma d’accorder de nouveau de l’importance à leurs films anciens, le traitement de ces derniers est réalisé en vue d’une rentabilité. C’est pour cela qu’ils engagent des transformations lors des restaurations, afin d’adapter ces productions à l’œil et au goût du public contemporain, afin d’avoir plus de chance de le séduire et de l’attirer. Le succès Metropolis, revisité par Giorgio Moroder, fait effectivement miroiter qu’il est possible de générer du profit en trahissant l’objet. Cela entraîne toujours plus de discordes et de débats entre les différents acteurs au sein du milieu cinématographique.
Conclusion
La restauration cinématographique, depuis sa naissance dans les années 1930 jusqu’à nos jours, a connue de nombreuses transformations. Née de la passion de cinéphiles qui ne supportaient plus de voir les films qui les avaient fait aimer le cinéma disparaître, soit parce qu’ils étaient fragiles à cause de leur support nitrate pour la majorité et finissaient par “s’autodétruire”, ou encore parce que l’industrie du cinéma ne leur trouvait pas la rentabilité “nécessaire” pour les conserver et donc finissaient par les détruire. La restauration a été, au moment de sa création et de son implantation dans le milieu cinématographique, un instrument de “sauvetage”, désorganisé, sans réel acteur identifié, à part les cinémathèques avec une démarche plus proche de la conservation que de la restauration, et s’organisant sans règles précises.
Les cinémathèques ne possédant que très peu de ressources techniques et du matériel nécessaires, les laboratoires commerciaux et leurs techniciens firent alors leur entrée. Bien loin de leur travail de production commerciale, les laboratoires utilisèrent leurs connaissances techniques, mais les limites de l’argentique et de la photochimie ne garantissaient pas toujours de bons résultats, et les cinémathèques choisirent alors de conserver “l’histoire” des films, plus que leurs visuels. En parallèle à cette démarche, d’autres acteurs du cinéma réalisèrent les “premières restaurations”, démarche qui consistait cette fois à réaliser le montage le plus long possible d’un film qui paraissait mutilé, et à partir de recherches sur le film encore limités (trouver le plus de copies du film pour pouvoir les assembler en une unique, sans soucis de respecter ou tout du moins de tenter de restituer le film originel), donnant ainsi des résultats pour la plupart éloignés du film initial sorti en salle à l’époque de sa création. Pire encore, ces restaurations ont engendrées parfois la perte de films originaux, lorsque ces “restaurateurs en herbe” n’avaient que peu de respect pour le matériel initial, et réalisaient des coupes physiques, à même la bobine originale.
À partir des années 1970 – 1980, deux camps s’affrontent et deux définitions d’une “bonne restauration” s’opposent : ceux qui veulent une restauration la plus proche possible du film original, qui respecte au maximum les techniques, choix esthétiques, etc, du créateur ; et ceux qui veulent redonner le caractère “spectaculaire” des œuvres, en réalisant des restaurations qui n’hésitaient pas à ajouter ou supprimer des éléments et séquences par rapport au film initial. Pour tenter de remédier à ses divergences de visions de la restauration cinématographique, les acteurs du cinéma et de la restauration tentent de se professionnaliser dans les années 1980 – 1990, donnant pour résultat des règles de restauration pour tous, mais qui par leur caractère seulement déontologique, n’obligent en rien les acteurs à les suivre, et ne va donc pas empêcher les pratiques d’être différentes, et parfois destructrices pour les films et l’histoire du cinéma.
L’arrivée du numérique dans le secteur dès les années 1990, n’a fait qu’accentuer les divergences d’opinion. Grâce à ces nouveaux outils, permettant de toucher et modifier encore plus en profondeur les films, sont nés des films particulièrement retouchés, dans leur narration comme leur esthétique, créant ainsi des films radicalement différents des originaux, avec des effets qui n’existaient pas à l’époque de leur création, et créant ainsi des distorsions historiques et techniques, induisant le spectateur contemporain en erreur, tout cela en ayant une mention “film restauré”. Mais le numérique a aussi apporté de réelles avancées dans le milieu de la restauration, permettant d’accéder à des films jugés trop abîmés à l’époque pour pouvoir être restauré avec l’outil argentique, et nombre d’acteurs, notamment ceux que l’on a interrogé, s’entendent à dire que l’outil numérique représente un vrai plus pour la restauration.
Mais alors, quel est le réel problème dans la restauration cinématographique ? À travers cette étude, on se rend compte que le numérique n’est qu’un facteur aux problèmes que rencontrent les restaurations. Il n’est qu’un outil, tout comme l’argentique, dont c’est l’utilisation faite, les parties prenantes des projets de restauration et les “règles” qui entourent ces projets, qui sont les facteurs de ses dérives. Le numérique n’a fait que mettre un peu plus en lumière les dérives et désaccords du milieu. Malgré la professionnalisation du secteur de la conservation et de la restauration cinématographique, aucunes lois et aucuns moyens de sanction n’existent, laissant les acteurs libres de faire ce qu’ils souhaitent. Des institutions, comme le CNC, se retrouvent alors pieds et poings liés, face aux seuls acteurs des projets possédant des droits et ayant le pouvoir de décision : les ayants droits et les propriétaires. Les ayants droits sont pour la plupart étrangers au monde du cinéma, ou font parti de l’industrie cinématographique (producteurs…) et ne connaissent pas forcément l’histoire du cinéma, mais même lorsque ce sont les créateurs du film originel eux-mêmes, le produit initial n’en est que plus changer et modifier.
Quel avenir pour la restauration cinématographique ? Les outils, numériques ou argentiques, n’étant pas les causes des dérives, les plus gros enjeux de la restauration vont être de réussir à mettre tous les acteurs (conservateurs, historiens, ayants droits, techniciens…) d’accord sur une seule et même “charte de la restauration cinématographique”, et de constituer une autorité, qui pourra sanctionner les dérives qui auront été établis préalablement, pour ne plus laisser l’ayant droit ou le propriétaire comme seul juge de la restauration. La restauration cinématographique est encore un secteur jeune – il a moins de 100 ans – et il doit trouver ses limites et se structurer, afin que le cinéma et son histoire n’en sortent que plus grands et qu’ils continuent d’émerveiller les spectateurs du monde entier, à travers les époques et les styles.
Définitions
Cinématographe* : Appareil servant à enregistrer des photographies animées et à les projeter sur un écran.
Ayants droits** : Un ayant droit est une personne ayant acquis un droit d’une autre personne. Un ayant droit est le plus souvent un membre de la famille de la personne dont elle tire son droit, mais ce n’est pas toujours le cas. Un ayant-droit peut être une personne physique ou une personne morale (une société, une association…). Dans cette étude, se sont les ayant-droits au regard du droit d’auteur (héritiers, sociétés de distribution…).
Contretype*** : Duplicata d’un phototype négatif ou positif obtenu par contact.
Collure**** : Soudure servant à racoler deux plans de montage d’une pellicule cinématographique.
Philologie***** : Ancienne science historique qui a pour objet la connaissance des civilisations passées grâce aux documents écrits qu’elles nous ont laissés.
Indicialité****** : Valeur d’indice, de preuve.
Annexes
Annexe 1 : Grille de questions (classée par enjeux)
La restauration cinématographique numérique et son fonctionnement technique :
Qu’est ce que la “restauration numérique” ? Quelle est la vocation de la restauration ? Son but ? Son utilité ? Son fonctionnement ?
Pourquoi restaure-t-on des films (purement technique ou plus encore) ?
Pourquoi “restaurer” et pas seulement “copier” ? Quelle est la différence entre “numérisation” et “restauration” ?
Quels types de recherches sont réalisées pour la restauration ? Sur l’œuvre ? Le réalisateur ?
À quel moment parle-t-on de “version originale”, de “version restaurée” et de “nouvelle oeuvre” ? Définissez-nous ses termes selon vous.
Est-ce que l’on restaure et conserve les films tout par le numérique ou le numérique ne permet pas de tout restaurer ? Y-a-t-il des limites à la restauration numérique ?
Comment fonctionne la restauration numérique et quels sont les (nouveaux) outils que l’on utilise dans le numérique ?
Pourquoi les nouveaux logiciels et outils favorisent la perte de données et contenus ?
C’était quoi la “restauration” avant le numérique ? Qu’est-ce que le numérique a changé?
Quelles sont les contraintes et avantages liés au support argentique ? Quelle forme prenait-il ?
Quelles sont les contraintes et avantages liés au support numérique ? Quelle forme prend-il aujourd’hui ?
Y-a-t-il eu des cas de pertes de film avec le numérique / depuis le numérique ?
Quel est le premier film qui a été restauré ? Pourquoi a-t-il été restauré ? Par qui ? Comment, par quel procédé ?
L’histoire de la restauration cinématographique numérique :
Quels sont les critères de sélection pour qu’un film soit restauré ?
Qui peut demander une restauration ? D’où est ce que ça part ?
Pensez-vous que les vieux films font l’objet d’un nouvel engouement depuis les 20 / 30 dernières années ?
Définition d’un “film patrimoine” ? Pourquoi ressort-on des films de patrimoine ?
La restauration de film ne concerne-t-elle que des “vieux films” ? Si non, quels autres films la restauration prend en compte ?
Quel public pour un film restauré ? Ouvre-t-on un public ? Le séduit-on ? Et la restauration devient-elle un outil pour tout cela ?
Est-il possible d’envisager une restauration en fonction du public (du moment de sortie de l’œuvre) et pas seulement du réalisateur ?
La restauration implique-t-elle forcément le respect de l’œuvre originale ?
Dans le cas de retouches demandées par le réalisateur au moment de la restauration, peut-on encore parler de “restauration” ?
À partir de quel moment la “restauration” devient “transformation / modification” ?
Quels exemples de controverses y-a-t-il eu dans le monde de la restauration ?
Les aspects économiques de la restauration cinématographique numérique :
Combien coûte une restauration ?
Quels types de subventions existent pour la restauration de film ?
Qui peut bénéficier de subventions pour restaurer un film ?
Quelles sont les retombées économiques (s’il y en a) ? Et à qui ça revient ?
Le droit français et la restauration cinématographique numérique :
Y-a-t-il des lois qui régissent la restauration ?
Qui a le droit d’ordonner des corrections en dehors du réalisateur / et du nettoyage ?
Quelles sont les dérives possibles et reconnues par le droit (ou non) ?
Quelles peines peuvent être engagées ?
Avis personnel sur la question de la part des personnes interrogées :
Est-ce qu’on restaure des films de la même manière dans le monde, suivant les pays?
Trouvez-vous que les italiens (ou un autre pays) sont en avance sur la restauration par rapport aux français, d’un point vu technique et / ou historique (éthique) ?
Qu’est ce que vous pensez de la restauration ?
Annexe 2 : Entretien avec Dimitri Vezyroglou – 13/11/18
Dimitri VEZYROGLOU, Maître de conférence cinéma à Paris 1, Chargé de cours en Master CMW et Enseignant à l’École du Louvre – Dites-moi donc, votre sujet précisément vous l’avez formulé déjà comment ?
Marina GRAESEL – La problématique on l’a posé de la façon suivante : « La restauration cinématographique par le numérique, dérive ou plus value ? »
Dimitri VEZYROGLOU – D’accord. D’accord très bien. Il y a une autre personne par ailleurs que vous devriez rencontrer, mais je vous l’avais déjà citée, c’est Béatrice de Pastre.
Marina GRAESEL & Charlotte DA CUNHA – Oui.
Charlotte DA CUNHA – Oui on est rentrées en contact avec elle aussi.
Dimitri VEZYROGLOU – Vous êtes rentrées en contact avec elle aussi. Et elle vous a répondu ?
Marina GRAESEL & Charlotte DA CUNHA – Oui.
Dimitri VEZYROGLOU – Vous avez de la chance (rires). Non mais je l’a connais très bien et je sais que au poste où elle est malheureusement, enfin malheureusement…
Charlotte DA CUNHA – Elle est très très occupée.
Dimitri VEZYROGLOU – Oui elle est très très occupée, mais bon sur ce sujet là, elle a vraiment une expertise qui vous sera très très utile. Vous êtes allé chercher du côté des laboratoires aussi ou pas ?
Marina GRAESEL & Charlotte DA CUNHA – Oui.
Charlotte DA CUNHA – On a essayé de rentrer en contact avec le laboratoire…
Marina GRAESEL – Image Retrouvée.
Dimitri VEZYROGLOU – L’image retrouvée oui…
Marina GRAESEL – Mais on a pas eu de réponse par mail pour l’instant, mais on va essayé de les contacter par téléphone du coup.
Dimitri VEZYROGLOU – Oui oui insistez un peu.
Charlotte DA CUNHA – On laisse un petit délai, on a envoyé le mail la semaine dernière et puis on va appeler d’ici demain.
Dimitri VEZYROGLOU – Oui oui, et puis bah peut être que Béatrice vous orientera vers un autre laboratoire, chez Kodak ou autre. Parce que c’est vrai que eux, ils sont directement confrontés à ça. Et pour peu qu’il y ait des gens aussi qui, enfin ce qui sera intéressant avec Béatrice c’est que c’est quelqu’un qui n’est pas une restauratrice elle-même mais elle dirige les collections du CNC et elle y travaille depuis suffisamment assez longtemps pour avoir vécu ce passage justement de la restauration argentique à la restauration numérique. Sur lequel moi je pourrais vous dire un certain nombre de choses, alors oui autre chose… Autre ressource que vous pourriez, si vous l’avez pas déjà fait, consulter assez facilement, faudrait aller chercher ça sur le site de la cinémathèque française, c’est l’enregistrement / captation des Journées d’étude, enfin ils appellent ça « colloque » mais c’est pas vraiment un colloque, c’est une série de conférences qui se font en ouverture du festival « Toute la mémoire du monde ». Le Festival – Toute la mémoire du monde est un festival qui se tient tous les ans au mois de mars. Et d’ailleurs ça vaudra peut être le coup que vous… je ne connais pas le programme de la journée de conférences en ouverture du festival cette année, aux alentours de la mi-mars. C’est un festival avec pour sous-titre « festival international du film restauré », donc vraiment un festival sur la question de la restauration, avec essentiellement des projections, des ciné-concerts, etc. Il y a eu notamment une année dédiée à la couleur pendant la journée d’ouverture / la journée de colloque. Durant cette journée, il y a eu l’intervention d’un professionnel d’une société qui produit les outils numériques qui permettent la restauration, dont notamment les techniques de transfert et de reproduction de la couleur de l’argentique au numérique. Ce sont des choses très techniques, mais en même temps, à partir de ces questions très techniques, ont peut inférer des réflexions plus larges, à la fois en matière, on va dire, d’éthique de la restauration et concernant les pratiques, le professionnel expliquait que les outils que l’on a aujourd’hui, sont très très avancés mais que l’on arrive pas, pour des questions de physique, à caler la balance des couleurs telle que l’on peut l’obtenir avec l’outil numérique sur celle de l’argentique, en tout cas sur celle de certaines pellicules argentiques. C’est-à-dire qu’il expliquait que quand on veut transférer une image, on doit caler les couleurs, l’étalonnage des couleurs, or sur certain type de pellicules, si on calle l’outil numérique, les 3 couleurs primaires qui servent de repère, on part du rouge, alors le jaune et le bleu vont être décalés et inversement si l’on se cale sur une autre des 3 couleurs. Bon, des choses qui, du point de vue du spectateur ordinaire, ne saute pas aux yeux, mais en réalité, il se passe toujours une sorte de mini-trahison de l’objet initial, dont il faut avoir conscience et qui ensuite, le numérique permet tellement de choses que probablement ça reste un atout et une avancée. On peut faire infiniment plus de choses avec le numérique que ce que permettait la restauration physique des copies argentiques auparavant, en terme justement d’étalonnage, d’harmonisation des contrastes, d’effacement des défauts de la pellicule aussi (rayures, etc…), de traitement du son, c’est aussi très important, mais d’une certaine manière, on peut faire tellement de choses que le danger est de vouloir justement polir la copie de telle manière que l’on arrive à un objet qui en réalité n’est plus, enfin… de toute façon ce n’est plus la même chose voilà ! De toute façon, il faut partir du principe que ce que l’on obtient avec un transfert numérique, et a fortiori s’il y a restauration, c’est que l’on arrive à un artefact qui n’est pas le film d’origine, voilà, c’est autre chose. C’est souvent très bien, mais c’est autre chose, mais parce que tout simplement le support n’est pas le même, donc le rendu n’est pas le même, le grain n’est pas le même, la luminosité n’est pas la même, etc… et si en plus on ajoute des corrections, voir parfois des effets, ça, Béatrice vous le racontera peut être, mais elle elle avait supervisé, il y a 6 ou 7 ans, la restauration du film Tess de Roman Polanski, qu’il a tourné en Angleterre à la fin des années 1970 et qu’il a restauré au début des années 2010 avec le CNC. Roman Polanski est toujours vivant, il a donc participé au processus de restauration et elle m’avait raconté qu’il y avait un moment où il s’est dit « Ah oui mais là sur telle scène, en fait, je me souviens qu’à l’époque je voulais faire un effet particulier mais qu’on pouvait pas le faire avec les moyens qu’on avait à l’époque, mais maintenant avec le numérique on peut, donc voilà je vais insérer cet effet ». Mais en fait, le CNC a réussi à lui dire que non on ne peut pas faire ça parce que c’est un film de 1979 donc il faut que ça reste un film de 1979 et que si on rajoute un effet numérique de 2012, ce n’est plus le même film, c’est plus le même objet, avec tout ce que cela veut dire aussi avec ce que le spectateur du futur risque de perdre en connaissance de l’histoire du cinéma et que si dans 50 ans, dans 100 ans, on voit le Tess restauré en 2012, à la rigueur si on a perdu un peu l’histoire de la technique cinématographique, ce film risque de nous induire en erreur en nous faisant penser que l’effet était possible en 1979, alors qu’en réalité non, donc voilà… En effet ça pose tout un tas de problème de ce genre là qui sont épineux. C’est-à-dire qu’à chaque film, y a un cas d’étude à part parce que d’un côté on a cette palette d’outils incroyable qu’offre le numérique, incomparable avec ce que l’on avait auparavant quand on devait traiter matériellement, physiquement la pellicule et d’un autre côté, le risque de trahir l’objet, de le travestir, de le modifier à tel point que finalement il ne soit plus le même. Cela a été le cas dans les mêmes années 2011/2012, de la restauration de la Grande illusion de Jean Renoir, un film de 1937, considéré comme l’un des summums de l’histoire du cinéma français et même de l’histoire du cinéma tout court, et qui a été restauré à partir du négatif original qui se trouve à la cinémathèque de Toulouse, mais par Studio Canal qui en détient les droits, par un système de droit sur les films, ça va, ça vient, c’est des histoires de rachat de catalogue, etc, donc bref c’est les droits se sont retrouvé à Studio Canal. Ils ont fait une restauration qui est assez spectaculaire, pour ceux qui connaissaient le film d’avant, dans le sens où les contrastes sont rétablis de manière très très nette, et surtout le travail sur la bande son est incroyable parce que légendairement, c’est un film qui était célèbre pour avoir une bande son assez pourrie à vrai dire où il y a des moments où l’on entendaient pas très bien la balance entre les dialogues et les musiques qui n’était pas bonne. Pour avoir vu la restauration, au moment où elle est sortie, c’était spectaculaire parce que l’on entendait le moindre mot du dialogue et on pouvait distinguer, la balance des sons était parfaite, le son était complètement nettoyé. Alors le problème c’est que l’on a un objet parfait, voilà, très très beau, mais est-ce que ce film a été vraiment vu comme cela en 1937 ? Et entendu comme cela ? Avec les moyens d’enregistrements et de reproduction de l’époque ? Alors ça n’est pas pour dire que c’était mieux avant, et pour dire qu’il faut toujours conserver les choses en l’état, mais il faut juste en avoir conscience et puis être capable de dire à un certain moment « Non là c’est trop » ou « Attention, il faut… ». Ce qui devient difficile parce que d’une part le patrimoine cinématographique et des films anciens sont devenus un objet culturellement, médiatiquement très important avec une exposition qu’il n’y avait pas il y a 25 ans, c’est vraiment… aujourd’hui on est vraiment dans une… et il y a une floraison de festivals qui portent sur les films anciens, il y a eu depuis les années 2000 l’ouverture de sections patrimoine dans les grands festivals internationaux, à commencer par Cannes, avec la fameuse section « Cannes Classiques », qui expose une sélection des meilleures restaurations de l’année, donc c’est vraiment la restauration qui est exposé en tant que tel à Cannes, ou encore Venise et Berlin on fait la même chose à peu près. »
Marina GRAESEL – Mais à quoi c’est dû justement cette envie de … ?
Dimitri VEZYROGLOU – C’est du à plein de choses en réalité. C’est du alors d’abord à une “vogue”, une vague, une vogue oui patrimoniale plus large. Depuis les années 1980 globalement, il y a une politique de valorisation, avec d’un côté une politique publique de valorisation du patrimoine culturel en général, avec les journées européenne du patrimoine qui ont été créé en 1984 si je ne me trompe, qui ont un succès énorme d’années en années, il y a toujours plus de monde qui y participe, de public, donc voilà. La floraison des festivals, bon, y a une passion pour le patrimoine qui s’est dégagée depuis une trentaine d’années environ, en France mais pas seulement. Mais à côté de ça, y’a eu une évolution de l’histoire du cinéma, des techniques de conservation aussi, mais bon l’histoire du cinéma a beaucoup évoluée depuis les années 1980 aussi. Elle c’est « scientifisicée » si on peut dire, y a des fonds d’archive qui se sont ouverts, des recherches très nombreuses qui se sont engagées dans l’histoire du cinéma, etc… Donc tout cela est porteur aussi d’une connaissance accrue sur le cinéma du passé et puis il y a eu aussi des évènements alors la pour le coup la France a été, je ne dis pas en retard, mais en décalage par rapport à d’autres pays, en particulier l’Italie qui a été assez précoce. Dès le début des années 1980, il commence à y avoir des festivals de ce genre là, des festivals exclusivement dédiés au patrimoine cinématographique, donc en Italie c’est les « Journées du cinéma muet » de Pordenone dans le Frioul, et puis surtout à partir de 1986, le festival « Le cinéma retrouvé » qui se tient à Bologne. Le festival est d’ailleurs à l’initiative de la grande cinémathèque de Bologne, qui est l’une des plus grandes cinémathèques italienne. Les italiens avaient déjà commencé avant et en France c’est plutôt au début de la première partie des années 1990 qu’il y a une série d’initiatives qui vont vraiment exposées, mettre en avant le patrimoine cinématographique de manière très frappante. Il y a trois événements presque synchrones : en 1990, il y a l’adoption de ce que l’on a coutume d’appeler le « Plan Nitrate » dont le vrai nom est « Plan de sauvegarde des films anciens ». C’est un plan national, sur le budget de l’Etat, piloté par le CNC, qui consiste en une politique de sauvegarde systématique et raisonnée de films qui n’existent que sur support nitrate. Depuis les origines du cinéma jusqu’au milieu des années 1950, les films en 35 millimètres, donc le format standard pour la projection en salle, étaient réalisés sur une pellicule, donc le support physique, un support photosensible, étaient faites dans un matériau qui était le nitrate de cellulose. Un matériau très performant, lumineux mais qui présente des inconvénients dont 2 très graves : l’un qu’on connaissait dès l’époque et l’un qu’on a découvert plus tardivement. Le premier est qu’il est extrêmement inflammable, terriblement inflammable, c’est-à-dire que s’il prend feu, c’est un feu totalement inextinguible. Cela peut être désastreux, et il y a eu des incendies très très célèbres dans l’histoire du cinéma, notamment celui des entrepôts de la Fox dans les années 1930, qui a perdu quasiment l’intégralité de sa production muette. Le deuxième inconvénient est que le support à tendance à se dégrader très rapidement, il a fallu un recul de plusieurs décennies pour s’en rendre compte, c’est qu’autant qu’il est dans un bon état, c’est un très bon support, probablement le meilleur de tout ou en tout cas celui avec une luminosité parfaite et une profondeur, mais cela ne résiste pas au temps et la pellicule peut avoir au bout d’un moment tendance à se rétracter, une décomposition de la gélatine, etc… et au bout d’un moment, le film devient totalement inutilisable. »
Marina GRAESEL – Et du coup est-ce qu’il a été possible de créer un support aussi performant ?
Dimitri VEZYROGLOU – Alors oui, donc du coup comme on connaissait l’inflammabilité, pour tout ce qui était format réduit (19,5 millimètres, 17,5 millimètres, 16 millimètres puis 8 millimètres) on faisait sur une pellicule ininflammable, donc sur un autre type de pellicule, en tout cas à partir des années 20. Mais quand on a décidé d’arrêter avec le nitrate parce que décidément c’était trop dangereux, ça a été remplacé par un support ininflammable, donc un film ininflammable, que l’on a l’habitude d’appeler le support Acétate, en réalité c’est du Tri Acétate de Cellulose, c’est le terme technique mais par contre on s’est rendu compte là encore avec le temps qu’il est sujet lui aussi à des dégradations mais pas les mêmes, c’est à dire qu’en réalité la pellicule est susceptible de contracter une sorte de syndrome qu’on appelle le syndrome du vinaigre, parce qu’en fait, plus une pellicule devient malade, plus elle dégage une très forte odeur de vinaigre en fait, mais bon s’il n’y avait que l’odeur de vinaigre, ça ne serait pas grave mais en réalité ça affecte l’image et en particulier pour les films en couleur, ça a des incidences, c’est à dire que les couleurs commencent à virer, vous avez un film qui devient tout rose. Et donc finalement, quand on a fini par se rendre compte de ça, dans les années 80, on a mit en place un nouveau support qui lui a commencé à être utilisé début années 90, mais alors du coup on ne savait pas encore que le numérique allé l’emporter 10-15 ans plus tard, qui est le support en polyester. Donc la dernière génération de copies argentiques, copies films, c’est des supports en polyester. Or le support en polyester, là on fait tout les tests, donc non seulement il est ininflammable mais en plus il résiste à l’épreuve du temps et on lui estime, dans des conditions évidemment de conservation, d’hygrométrie, température optimale, on lui estime une durée de vie entre 300 et 500 ans. Entre parenthèse, mais ça je l’avais dis en cours, rien à voir avec la pérennité d’un fichier d’email parce que là d’une part il y a le problème de la durée des supports des fichiers mais en support, ce que l’on appel un support antique, c’est à dire un DVD, ça a une durée de vie de 20 ans, 30 ans à peu près, un disque dur c’est 5 ans donc en fait, les supports sur lesquels on conservent les fichiers numériques sont très peu stables. Les fichiers numériques eux-mêmes sont instable, c’est à dire qu’à cause des changements de formats de lecture, il peut arriver qu’un fichier soit contaminé pour une raison ou pour une autre, qu’il perde des pixels et ça peut vous claquer entre les doigts, vous savez pas comment ni pourquoi mais ça peut arriver donc évidemment c’est très compliqué. De nos jours, pour revenir au Plan de Nitrate, début des années 1990, on met en place ce plan qui va être mise en œuvre à partir de l’année suivante, qui consiste à, sur des crédits d’État, donc l’État alloue ces plans de nitrates tous les ans une enveloppe d’argent et à partir de cette enveloppe, on va pouvoir sauvegarder un certains nombres de films durant cette année là, et là du coup il y a une concertation entre cinémathèque, sous l’autorité du CNC pour chacun arrivant avec sa liste de films à sauver et puis il y a un choix à faire. Donc ça s’est passé comme ça pendant une quinzaine d’années jusqu’au milieu des années 2000 puis le plan Nitrate a finalement pris fin, c’était un plan pluri-annuelle. On a évidemment pas pu sauvegarder tout encore donc il reste encore des films dont les copies sont sur support nitrate, mais même si le plan nitrate n’existe plus tel quel, en réalité, on continu. Y a toujours une enveloppe annuelle qui permet de sauvegarder des films, donc là on est entrain de parler de sauvegarde, pas de restauration parce que c’est une opération distingue, c’est juste le transfert d’une copie nitrate sur une copie polyester. Ce qu’il faudrait savoir, et vous poserez la question à Béatrice de Pastre, c’est si aujourd’hui on parle toujours de transfère sur pellicule parce que ça j’en suis pas sur, est-ce que le transfert s’opère pas directement par un scan, ce qui permet de sauvegarder sous forme de fichier le film quitte à ensuite opérer un retour sur pellicule. Parce que le problème quand le numérique est arrivé, il y a eu une sorte de mouvement de masse, « on va tout faire au numérique, production, on va tout tourner en numérique, la projection va être en numérique et puis les films anciens, on va tout basculer en numérique, c’est génial on peut tout sauvegarder ». En réalité on avait pas anticipé à ce moment là, un certain nombre de problèmes, dont ce que je vous ai parlé mais aussi d’ailleurs des problèmes de conservation, c’est à dire que quand on a 100 films chez soi, ça tient sur un disque dur qu’il faut néanmoins changer tout les 5 ans mais vous imaginez des archives du films qui ont des milliers de titres… Là on est entrain de parler de serveurs, de disques dur géant qui font plusieurs pétaoctet de capacité qu’il faut faire tourner, ça consomme de l’énergie, ça prend de la place, il faut gérer, surveiller qu’il chauffe pas trop et quand il faut les remplacer, sa coûte aussi très cher donc voilà en réalité le numérique, je dirais, pose autant de problèmes qu’il n’en résout, néanmoins il en pose beaucoup.
Charlotte DA CUNHA – Est-ce qu’il y a eu justement des cas de pertes de films à cause du numérique maintenant ?
Dimitri VEZYROGLOU – Oh sûrement oui. Parce qu’en réalité quand le numérique est arrivé… vous savez qu’il existe en France, ce que l’on appel le dépôt légal de la cinématographie, au même titre que les livres… tout exemplaire d’un livre… tout livre édité en France, doit faire l’objet d’un dépôt à la Bibliothèque National, la BNF, et de la même manière depuis 1977, au départ c’était « tout film français produit en France », ensuite « c’était tout film diffusé en France » doit faire l’objet du dépôt d’une copie, non pas la BNF qui n’a pas les moyens et la culture pour conserver ça mais par délégation, ce dépôt s’effectue au CNC. Et simplement, évidemment, les producteurs râlaient un peu parce que, à tirer, une copie ça coûte de l’argent quand même, c’est pas… Ils aiment pas cette idée, donc quand le numérique est arrivé, voilà, on va vous déposer des DCP uniquement et sans prendre en compte tous ces problèmes de conservations. Et donc Béatrice de Pastre, qui gère justement l’outil du CNC, de ce dépôt légal, essaye de se battre encore maintenant pour obtenir un retour sur pellicule parce que c’est le support de conservation le plus pérenne en réalité.
Marina GRAESEL – Mais qu’est-ce que sont des DCP ?
Dimitri VEZYROGLOU – Les DCP sa veut dire « Digital Cinema Package » et c’est comme un disque dur mais en plus petit, qui contient un film. C’est ce qui sert à la projection numérique c’est à dire qu’avant en fait on arrivait dans les cinémas avec… le distributeur faisait livrer des boîtes de copies. Aujourd’hui, on livre donc un petit disque dur qui est protégé par des DRM, et que l’exploitant branche en fait sur son projecteur et qui peut projeter tant de fois parce que, par contrat de distribution, l’exploitant a le droit de projeter tant de fois le film. Ensuite, il rend le DCP au distributeur, donc ça c’est le DCP donc c’est plus avantageux parce que pour le coup, ça coûte rien à produire.
Charlotte DA CUNHA – C’est exclusif au cinéma comme support, on le retrouve pas dans d’autres milieux ?
Dimitri VEZYROGLOU – Le DCP à ma connaissance oui. Là pour le coup, je ne suis pas assez expert en technique, donc je ne saurai vous expliquer pourquoi mais… Oui d’ailleurs ça s’appelle « Digital Cinema Package » donc…
Charlotte DA CUNHA – Et ça a été conçu pour ça en tout cas ?
Dimitri VEZYROGLOU – Oui ça a été conçu pour ça… Pour revenir à ce début des années 90, sur la fièvre patrimoniale. Donc, il y a ça, le Plan Nitrate, qui quand même offre aussi une visibilité à l’action de l’État, en matière de restauration et de sauvegarde au moins. Il y a l’apparition en 1991 d’un festival qui va durer 6 ou 7 ans, jusqu’en 1997-1998, le festival qui s’appelait « CinéMémoire » et qui a eu beaucoup de succès. En tout cas dans les 5-6 premières années et puis on va dire qu’après, pour des raisons un peu interne au festival, ça a fini par un peu capoter. Mais en tout cas, dans les années 1991-1992-1993-1994, ça a eu une visibilité très importante, c’était un festival de films anciens, particulièrement du muet, et qui étaient diffusés dans plein d’endroits, dans des salles de cinéma mais pas seulement, dans des théâtres aussi… Ça a beaucoup plus à la population, notamment parce que c’est généralisé particulièrement à ce moment là, la forme pour la diffusion du film muet, la forme du ciné-concert : le fait de représenter vraiment le cinéma muet avec un vrai accompagnement musical en direct, etc… Enfin c’est un nouveau type de spectacle qui a beaucoup plu, il y a eu un peu un engouement, un vrai engouement public autour de ce festival.
Charlotte DA CUNHA – Et ça existait à l’époque, quand les films muets ont été créés, cet orchestre accompagnant ou ça a été créé en 1990 pour le « nouveau public » ?
Dimitri VEZYROGLOU – Ah non ça existait dès le départ ! C’est à dire qu’il y a jamais eu, à l’époque de ce que l’on appelle « le muet », il n’y a jamais eu de projection silencieuse. En réalité, elles étaient toujours accompagnées de musiques et au minimum, même si c’était dans une petite salle, comme un café dans un village, parce qu’il y avait ça aussi comme type de projection, au minimum on mettait un phonographe si on avait pas un pianiste ou un violoniste à disposition. Et puis après, c’était un ou deux musiciens, ou dans une très grande salle, ça pouvait aller jusqu’à un orchestre de taille symphonique. Donc il y a toujours eu, plus les bruits, le bruitage parfois, plus le boniment… Parce qu’il y avait parfois un accompagnement verbal du film muet, donc ça a toujours existé. Après, pendant des décennies, on a continué à voir des films muets dans les cinémathèque ou dans les ciné club, mais on avait perdu ça, du coup on les projetaient en silence. Et pour avoir vécu (rires) la fin de cette période là, notamment à la Cinémathèque Française, quand vous alliez voir des muets, c’était terrible parce qu’un film d’une heure trente, sans aucun bruits, sauf le bruit de la personne qui commence à ronfler (rires)… Ce genre de chose c’est quand même assez élevé, donc il y a toujours quelqu’un qui finissait par s’endormir (rires). Donc là, du coup, il y a un accompagnement sonore mais c’est les gens qui interpelle, les gens qui se moquent… Mais sinon, c’est des projections qui étaient silencieuses, donc c’était contre-nature, c’était pas fait pour ça.
Charlotte DA CUNHA – C’était pas fait, oui, comme à l’époque donc ?
Dimitri VEZYROGLOU – Non absolument pas. Et donc là, le Festival CinéMémoire a joué un rôle important pour l’avènement, enfin la prise de conscience que non, le film muet d’abord on peut en voir, et quand on les voit, en particulier des films restaurés, parfois avec des tintages de couleurs de l’époque etc, plus une musique avec des musiciens qui jouent devant vous, là pour le coup ça devient un autre spectacle et ça a beaucoup plu. Désormais, il doit en avoir encore je pense des projections de muet silencieuses, mais de moins en moins. Ça devient quasiment obligatoire, même dans les cinémathèques, de prévoir un accompagnement musicale. Donc il y a eu ce Festival CinéMémoire qui a prit fin et puis il y a eu tous les événements en 1995, autour du Centenaire du Cinéma. Ça a été un moment très important, parce qu’il y a eu une efflorescence de manifestations de tous ordres, des projections, mais aussi des manifestations scientifiques : des colloques, des publications, des conférences etc… Plus des rétrospectives, des performances autour de l’Histoire du Cinéma et autour des films anciens. Donc voilà il y a eu un moment un peu pallier comme ça, au début des années 1990, qui a relancé l’intérêt pour le patrimoine cinématographique dans un contexte où de toute façon, l’intérêt pour le patrimoine en général était déjà important. Voilà en gros, quelques éléments de réponses à votre question.
Charlotte DA CUNHA – Mais du coup la restauration, elle est née avec ce nouvel attrait pour le patrimoine ou elle existait déjà avant ? La restauration, sans parler de sauvegarde.
Dimitri VEZYROGLOU – Ça vous en parlerai de façon plus précise avec Marie Frappat. Mais non ça a existé, en réalité ça existait même très tôt d’une certaine manière, dès la fin des années 1920, quand on a commencé un peu à… Bon vous savez la fin des années 1920, c’est le moment de la transition parlante, premier film parlant : 1927, en France, il est diffusé sur “PianoJazz” donc à partir de janvier 1929. Puis l’engouement est tel pendant l’année 1929, on se rend compte que c’est irrépressible et qu’on est en train de passer vers… ce qui n’était pas nécessairement prévu au départ… Et à ce moment, les cinéphiles, les gens qui avaient vraiment un attachement au cinéma, à l’histoire du cinéma, à la mémoire du cinéma, ont pris conscience qu’on risquait de tout faire disparaître, c’est à dire les films par lesquels on s’était formés, enfin qu’on avait aimé, qui nous avaient éduqué au cinéma, qui nous avait appris à voir, ému etc. Si ça trouve, on risquait de ne plus les voir du tout et de là, née une prise de conscience de conservation, d’une part et d’autre part la nécessité de montrer, de continuer à montrer ces films. Sauf que, on se rend compte que certains de ces films ne sont plus en bonne état ou sont incomplets, ou bien y a une copie incomplète d’un côté et une copie incomplète de l’autre et ça s’est produit en 1929, lors de l’automne je crois, lors de ce que l’on appelait le Gala Méliès, qui était en fait un hommage rendu à George Méliès de son vivant, puisqu’il était encore vivant. Et en réalité… enfin vous voyez on est au moment ou on s’apprête à basculer définitivement parlant et où un groupe de cinéphiles se dit « Ah mais finalement, mais qu’est-ce qu’il est devenu Méliès ? ». Ils se sont souvenu de ces films qu’ils voyaient dans leur jeunesse ou dans leur enfance qui les avait émerveillé etc… Déjà ces films on ne les voyez plus en réalité, ils étaient plus projetés nulle part, et par ailleurs Méliès avait disparu de la circulation… on savait qu’après avoir abandonné le cinéma en 1913, il est devenu marchand de jouets à la Gare Montparnasse, il a une petite échoppe, on finit par le retrouver, à le faire venir, on créer… Et à cette occasion là du Gala, on est venu faire des projections c’est là qu’on s’est rendu compte qu’on avait des copies, certaines étaient des copies de films parfois incomplètes et c’est là qu’il y a eu la première forme de restauration alors c’est très artisanal, très intuitif etc, mais grâce à l’aide de Méliès d’ailleurs, qui avait perdu, abandonné, jeté, brûlé peut être… ses archives personnelles mais enfin il en avait un bon souvenir, il a refait les desseins, en fait une sorte de storyboard en particulier de Voyage dans la Lune, l’un de ses films le plus célèbre qui a permis aux organisateurs du gala de, à partir de 2-3 copies différentes, de reconstituer au mieux, en remontant les bouts qu’ils avaient, qui étaient disjoint parce qu’ils appartenait à des copies différentes, reconstituer au mieux, au plus près de ce que Méliès leur avait indiqué comme étant le film original. Donc ça, on ne se dit pas le mot Restauration n’est pas utilisé, on ne se dit pas je suis entrain de restaurer le cinéma mais si vous voulez dans la pratique c’est la première fois que ça se passe… Donc ça dans les années 1930-1940-1950-1960, on continue à pratiquer ça un peu, à Abel Gance pour ce film Napoléon en 1955, fait ça avec Henry Monglois, le directeur de la Cinémathèque Française, il va chercher un bout de négatif, un bout d’une copie, etc, puis il essaye de remonter le film tel qu’il l’avait conçu, il y arrive pas vraiment mais toujours est-il que des tentative de ce genre, La Grande Illusion a été l’objet d’une restauration elle aussi dans ces années là. Et en fait les choses on changeaient mais ça, j’ai une chronologie un peu grossière dans la tête et je pense que Marie Frappat vous dira ça plus précisément mais dans les années 1970, là c’est vraiment un tournant parce que l’on assiste à une professionnalisation de la Restauration. C’est à dire que c’est plus le réalisateur qui arrive à la cinémathèque et qui dit : « Ah bon, vous avez une copie de mon film… Oui vous pourrez rajouter ça » ils échangent ensemble « mettre ce bout ci là et celui la, là » etc, on passe un peu de ce côté improvisé, intuitif etc, à quelque chose de plus formalisé, de beaucoup plus professionnalisé, technique aussi. Et du coup, où on commence à élaborer parallèlement à l’invention de forme un petit peu normées, une nomenclature aussi scientifique, professionnelle de la Restauration, les choses que l’on peut faire, ne pas faire, Quand on est devant tel type de problème, comment on doit faire quand c’est tel type de rayures, si c’est des rayures superficielles, on va les traiter comme ça, si c’est des rayures profondes, on va les traiter comme ça où les cinémathèques d’ailleurs pas qu’exclusivement en France, ça se produit un peu partout, encore une fois l’Italie a été un peu pionnière mais les cinémathèques sont en réseaux entre elles au sein de ce que l’on appelle la Fédération Internationale des Archives du Film : La FIAF est donc elles s’échangent des idées, des techniques et forment un petit ensemble… Et là ça va commencer dans ces années là et tout ça, alors en France ça va avoir une importance particulière car il se trouve qu’en France en 1969 à été créé un Service des Archives du Films au sein du CNC, donc au sein de l’organisme public chargé du Cinéma. Jusque là, les organismes qui conservaient les films et qui donc éventuellement procédaient à leur restauration, c’était des organismes… c’était des cinémathèques, des associations. Les cinémathèque sont pas public, du moins pas en France, y a des pays où ça l’est mais… Voltaire c’est un cas un petit peu particulier, c’est entre le public et le privé, entre fondation et service public, mais la cinémathèque Allemande par exemple, bon elle a été créé sous le troisième Reich mais,,, en URSS aussi,,, mais en France c’est les cinémathèques, elles géraient leur collections comme elles l’entendaient, même si c’était grâce à des subventions publiques mais elles étaient autonomes. Et en 1969, le CNC décide de créer un service de conservation en son sein et donc, sur des fonds publics, donc service de l’État, qui s’appellera : Service des Archives du Film, qui deviendra ensuite : Archives Française du Film et aujourd’hui c’est le service que dirige Béatrice de Pastre, qui n’a plus vraiment de nom, enfin c’est le service du patrimoine, les collections du service du patrimoine du CNC. Pourquoi c’est important ? Parce que du coup, là où les cinématécaires sont des gens qui viennent souvent de la critique de cinéma, des cinés-clubs, qui entrent dans ses organismes par cooptation, ils connaissent un tel… Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas de compétences, certains d’entre eux sont extrêmement compétent, mais c’est une compétence qui s’est acquise, il n’y a pas d école de la restauration, donc qui s’est acquise à l’école, acquise par la pratique. Là , bon y a toujours pas d’école de la restauration mais on va avoir un service qui va être exclusivement consacré à la conservation des films, des films des collections de l’État, puisque c’est de cela qu’il s’agit. Collections de l’État qui vont devenir très importante à partir de 1977 avec la création du dépôt légal dont je parlais tout à l’heure, car pour le coup c’est tous les films diffusés en France qui entrent dans la collection. Ça veut dire que l’État recrute du personnel pour s’occuper de ce film et c’est un personnel, qui est souvent passé par les laboratoires, qui doit avoir des compétences techniques et qui a les moyens, l’environnement pour se consacrer véritablement à ça. Parce que une cinémathèque a une grande variété de rôles, bien sur c’est un organisme de conservation mais pas seulement, c’est aussi et presque même d’abord une institution où on montre les films. Donc on les programme tous les jours, cette programmation elle doit être pensée, réfléchie, on accompagne les films avec des conférences, il y a des publications, bref, ils ont tout un tas d’activités. Le service des Archives du Films du CNC ne s’occupe que de ça, que de conservation il n’y a pas de salles, de programmation… et du coup il y a une partie du personnel qui peut, qui va pouvoir, dès les années 1970, se spécialiser, se consacrer à ces questions et de conservation et du coup de restauration, en lien avec ce qu’il se fait ailleurs dans le monde. Dans les années 1980 en plus, avec la politique culturelle qui est celle de Jack Lang, très en faveur du patrimoine justement… la mise en valeur du patrimoine, ça va être de plus en plus soutenu par les pouvoirs publics et puis il y a toujours un peu cette stimulation de l’exemple italien qui est juste de l’autre côté des Alpes où ils en font toujours plus, et ils commencent à être vraiment au point en matière de restauration aussi puisqu’au sein de la cinémathèque de Bologne, est créé justement le laboratoire L’Immagine Ritrovata donc l’Image Retrouvée dont l’actuelle “Image Retrouvée” avec qui vous essayez de rentrer en contact, c’est l’antenne parisienne en réalité. C’est la deuxième antenne qu’ils ouvrent à l’étranger, il y en a une à Hong Kong et donc celle ci qui a ouvert… mais parce qu’ils ont acquis, l’Immagine Ritrovata, qui a acquis un savoir faire mondialement connu, il y a des archives américaines, asiatiques, anglaises, allemandes qui leur envoi des films à restaurer parce qu’ils ont une technique vraiment en pointe mais pas seulement, ils ont une technique en pointe mais aussi une déontologie, une éthique de la restauration particulièrement appréciée et notamment le fait que, ça c’est David Epottes, le directeur du laboratoire à Bologne, qu’il explique de toujours partir de la pellicule en réalité. Là où justement, beaucoup de restaurateurs aujourd’hui, depuis le passage au numérique ont pour réflexe, quand ils ont une copie à restaurer, une copie en mauvaise état pour une raison ou pour une autre, c’est d’abord on fait scan, et puis après on travaille sur le fichier numérique, avec tous les outils numériques, or selon David Epottes, ce n’est pas la bonne manière de faire, il faut d’abord… tout le travail que l’on peut faire sur la pellicule et ensuite quand on a fait le maximum sur la pellicule, là on peut passer au numérique, et avec comme perspective… Il fait parti de ceux qui pensent qu’il faut par ailleurs revenir en pellicule ensuite mais au moins déjà faire tout le travail que l’on peut faire sur la pellicule elle même, parce que de ce fait là, on réduit, ce que je disais tout à l’heure, on réduit la part de risque, de trahison, de modification, de dénaturation de l’objet parce que néanmoins, on aura d’abord à faire à un film qui a été tourné en pellicule avec ces moyens là, à cette époque là, il faut quand même essayer de conserver ça au maximum. Si vous transposez ça dans un musée avec les tableaux, vous voyez bien l’équivalence même si c’est pas la même chose, vous voyez qu’on a à faire à une œuvre reproductible précisément etc… Mais néanmoins, ça ne viendrait à l’idée de personne d’utiliser des vernis synthétiques pour restaurer un Velasquez qui avait ses vernis à lui, si vous rajouter une couche synthétique dessus, vous modifiez en réalité, la nature même de l’œuvre à plusieurs siècles de distance et là, toutes proportion gardées, on a la même problématique, avec, donc, l’Image Retrouvée, L’immagine Ritrovata, pour son antenne française, sont un peu sur cette politique là. C’est à dire : on fait le maximum en pellicule et ensuite… Oui les outils numériques c’est très important, ça permet d’aller plus loin mais ça permet d’aller plus loin à partir d’un fichier qu’on aura déjà bien travaillé, enfin qui sera la base d’une image déjà bien travaillée en argentique.
Charlotte DA CUNHA – Donc de ce que je comprends, les italiens travaillent plus sur… avant de parler de sauvegarde et après du coup de la restauration, de passer par cette sauvegarde, ils pensent d’abord à restaurer ce qu’ils ont de base, et après basculer vers une sauvegarde, de transformer aussi mais vraiment avoir d’abord l’impact sur l’objet original en fait ?
Dimitri VEZYROGLOU – Ce qui n’empêche pas une première sauvegarde, c’est à dire que si c’est une pellicule nitrate qu’ils ont par exemple, ils vont d’abord la sauvegarder sur une pellicule, mais c’est une sauvegarde sur pellicule et ensuite travailler la pellicule pour ensuite la restaurer au maximum et puis un transfert sur numérique qui va permettre d’autres interventions impossibles quand on se limite à la restauration physique, en gros, ce que je sais, c’est leur manière, je l’ai entendu en parler, sans risquer de me tromper, c’est leur manière de travailler.
Marina GRAESEL – Et en opposition, ceux qui ne respecteraient pas trop cette éthique, pourquoi ?
Dimitri VEZYROGLOU – Ça coûte moins cher, ça prend moins de temps, c’est pas les mêmes procédés techniques, c’est à dire que… on pourrait se dire, parce que ça a été la logique aussi du passage au numérique au milieu des années 2000, tout ça, l’ère de l’argentique qui passe au numérique, on bazarde aussi tout le savoir faire qu’il y a autour, c’est à dire que c’est pour ça qu’ils travaillent… l’Immagine Ritrovata travaille, ils prennent en réalité peu de stagiaires. Pourquoi ? Parce qu’ils les forment à la restauration… parce qu’il y a plus vraiment d’endroits où l’on apprend tout ça… parce que si on peut se passer, puisqu’on a le numérique, on se passe de cet apprentissage là, la conservation de la transmission de ce savoir faire donc ça fait économiser de l’argent, évidemment on économise de l’argent puisqu’on ne transfert pas de pellicule à pellicule, on scan directement et ensuite on économise tout l’argent des interventions physiques sur la pellicule pour se concentrer sur les outils numériques… ça va plus vite et ça nécessite moins de personnel, un savoir faire en moins et donc ça coûte de l’argent toujours mais c’est plus rapide… Sauf que ça c’est un petit peu la loi du marché qui veut ça et qu’elle a un peu balayé tous les risques, les problèmes, les questions déontologiques, éthiques, scientifiques aussi… Qu’on peut se poser au sujet des manipulations numériques parce que… oui parce que l’autre élément consécutif de cette exposition croissante et cet envol croissant pour le patrimoine dont qui a par exemple pour manifestation que dans l’édition DVD qui se porte très mal comme vous le savez mais tout de même le secteur patrimoine continue à se maintenir, DVD de patrimoine continue à se vendre alors que le reste du DVD s’est un peu écroulé depuis 20 ans, Donc il y a un goût et puisqu’il y a un goût, y a un marché qui s’est créé et en réalité le marché du patrimoine cinématographique est devenu vraiment important et c’est là que les gens se réveillent car ils se rendent compte qu’ils ont dans leur catalogues tel ou tel film, et ils voient un voisin qui a fait un gros coup en sortant tel film restauré, je vais pouvoir faire pareil et il y a les détenteurs du catalogues, qui sont parfois de grosses sociétés du genre Studio Canal mais pas seulement, TF1 vidéos aussi c’est très typique de ça mais il y a aussi des ayants droit particuliers qui ont les droits sur des films et même s’ils disposent pas de la copie ils vont chercher à la faire restaurer auprès d’une société en espérant qu’ils vont pouvoir se faire de l’argent avec ça parce que donc il y a un vrai marché qui s’est créé, l’une des manifestation, et c’est là qu’on voit que les enjeux de marché sont importants, c’est que très souvent quand il y a une restauration, une restauration de prestige, je vous citais l’exemple de La Grande Illusion donc La Grande Illusion, depuis que la restauration Studio Canal est sortie, très belle restauration comme je vous le disais, a eu aussi des problèmes, Studio Canal interdit, elle en a mit 3 puisqu’ils détiennent les droits du films, interdit la projection des anciennes versions c’est à dire que même une cinémathèque qui dans ses fonds aurait une vieille copie argentique de La Grande Illusion, qui a un projecteur à argentique et qui, pourquoi pas c’est dans ses fonds, elle pourrait projeter sa copie de La Grande Illusion, n’en aurait pas le droit parce que c’est interdit par Studio Canal, qui n’autorise plus que la projection de la copie restaurée depuis 2012, alors pourquoi ? Parce qu’évidemment ça leur a coûté de l’argent, ils veulent rentrer dans leur frais et ils veulent exploiter au maximum cette objet ce qui signale évidemment qu’il y a un marché, Le problème c’est que, comme je vous le disais tout à l’heure, on aimerait bien de temps en temps pouvoir ne serait-ce que comparer, revenir à l’ancienne version, le voir en argentique, pourquoi pas, pour essayer de se rendre compte des différences, du travaille qui a été fait, de comment était la copie à l’époque, enfin vous voyez, ce genre de chose ;or on peut plus le faire et ça c’est vraiment la loi du marché qui l’a imposé…
Charlotte DA CUNHA – Donc cela voudrait dire que quelqu’un qui par exemple, cherche à travailler sur cette problématique, d’un point de vue scientifique, en faisant une thèse par exemple, il ne pourrait pas visionner s’il en avait besoin ?
Dimitri VEZYROGLOU – Alors, vu un visionnage individuel, je pense que ça peut toujours se faire, en vous mettant d’accord avec le cinémathécaire, les services de la cinémathèque, ce n’est pas toujours facile mais je pense qu’on peut arriver… arriver à rentrer dans les arcanes.
Marina GRAESEL – Et ça resterai légal ?
Dimitri VEZYROGLOU – Oui ça resterai légal, non parce que le problème c’est la billetterie, Le problème c’est que si vous faite une billetterie, des entrées payantes, avec une copie qui n’est pas une copie de Studio Canal, et bien en réalité, vous ne remboursez pas, d’une certaine manière, Studio Canal pour ses dépenses pour la restauration…
Marina GRAESEL – Et du coup, tout ça est régie par la loi du marché uniquement ou est-ce qu’il y a d’autres lois ?
Dimitri VEZYROGLOU – À ma connaissance, il n’y a pas de lois,, à part les lois qui réglementent les droits sur l’œuvre, parce que là aussi c’est complexe, c’est d’autant plus complexe qu’en réalité ça diffère selon les pays, Le droit d’auteur n’est pas le même en fonction des pays, C’est pas le même aux États-Unis qu’en France etc et que, dans le cas français c’est complexe parce que c’est régit par la loi de 57, qui a été re-modifié depuis, mais la base c’est la loi de 57 sur les droits d’auteurs, pareil pour les livres, c’est la même loi, mais qui dans le cas du cinéma, définie 5 auteurs pour le film, en réalité y a 5 personnes qui sont identifiées comme auteurs, Et théoriquement, en droits, on doit attendre,,, enfin une œuvre ne peut tomber dans le domaine public et être libre de droits, que 70 ans après la mort du dernier des auteurs, 5 ça fait beaucoup sachant que parfois il y a des rachat de droits enfin bref,, à savoir que dedans, il y a l’auteur de l’œuvre adaptée, l’adaptateur, le réalisateur, le musicien et le scénariste, Donc ça fait beaucoup de monde, ça rend les choses,,, pour répondre à votre question, il y aussi tout l’aspect juridique qui est bien évidement important qui est quand même,,, qui régule,, on va dire qu’une œuvre qui serait déclarée dans le domaine public, là on peut,, tout le monde peut s’en emparer d’une certaine manière, Pour le reste, la loi du marché et puis quelques cinématécaires ou quelques praticiens de la restauration qui tentent de promouvoir des approches réfléchies, complexes, un peu attentives pour se prémunir contre les risques mais après ils sont pas toujours entendu, Il y a, je sais pas si je vous l’ai signalé, il me semble que si, une controverse célèbre qui peut être intéressante pour vous puisqu’elle a laissé des traces, une publication d’une certaine manière, des pièces de la controverse que les différents acteurs de cette controverses ont publié leurs positions dans une revue au sujet du Voyage dans la Lune de Méliès justement et c’était il y a 5-6 ans, 2012, c’est l’éditeur Lobster, je sais pas si ça vous dit quelque chose mais c’est un éditeur de DVD et distributeur de films de patrimoine qui a,,, donc là c’était le moment où l’œuvre de Méliès était tombé dans le domaine public justement et qui a édité une intégrale Méliès, un intégral de films qu’on a conservé mais qui a part ailleurs procédé à part une restauration du Voyage dans la Lune [d’aujourd’hui] restauration numérique, pas la toute première mais ça en était une première visible, importante, c’était la meilleure à peu près au même moment que La Grande Illusion et en fait cette restauration, donc une restauration en couleur parce que Méliès colorisait ses copies lui même, enfin c’était son atelier qui le faisait, c’est lui qui concevait la colorisation et donc pour se faire, il est allé chercher la meilleure copie colorisée, existante, qu’il a trouvé dans les fonds de la cinémathèque de Catalogne, et c’est cette copie là qu’il a choisi de restaurer, Et c’est là que vous avez vu par ailleurs les petits drapeaux espagnol qui se changent en drapeaux français, parce que là c’était le film qui avait circulé en Espagne, donc le drapeau était espagnol mais il a rétabli le drapeau français en plein de détails mais qui pose un abîme de réflexion ; est-ce qu’on peut faire ça ? en réalité cette copie là c’était cette copie là donc est-ce qu’on a le droit de faire ça ? Donc il y a, lui qui s’est défendu, « lui » c’est Serge Bromberg, le directeur de Lobster, a défendu sa position, c’est quelqu’un qui est pas du tout un mercantile, Lobster c’est pas Studio Canal, c’est pas TF1 vidéos, c’est quelqu’un de sérieux, vrai cinéphile, passionné etc,,, mais la dessus, il a défendu sa position, et d’un côté, la cinémathèque de catalogne, et de l’autre, Béatrice de Pastre elle même, avec un historien du cinéma : Rolland Cosonlendet ont critiqué et assez fortement ce choix et exposer les problèmes que ça a posé, Ce qui est intéressant c’est que vous avez les 3 textes de Serge Bromberg, le texte du conservateur de la cinémathèque de Catalogne et le texte de Béatrice de Pastre et de Rolland Cosonlendet qui sont publiés dans le Journal of film preservation qui est la revu de la FIAF, Donc la vous trouverez le sujet en ligne puisque comme beaucoup de revues, au bout de certain temps,,, sont en disposition en ligne, donc ça c’était en 2012, parce que là on était au moment où on voyait, où apparaissait tous ces problèmes, donc 5-6-7 après le grand passage au numérique et nous on se rendait compte que « attention » qu’en fait il y a des points un peu problématiques, il faudrait peut être se poser un moment et réfléchir, parce que c’est pas tout blanc et tout noir, en réalité, le numérique pose aussi des problèmes, Donc ce dossier là est un peu le témoignage de là où on en était il y a 6 ans, Mais depuis on ne fait que continuer à soulever ce genre de problème, Donc tout à l’heure, je vous parlais du festival de Toute la mémoire du monde et de cette série de conférence, donc allez regarder sur le site de la cinémathèque française et donc, peut être l’année où il a été question de la couleur, mais en tout cas sûrement l’année dernière, donc le festival 2017, festival Toute la mémoire du monde 2017, la journée de conférence c’était consacré justement au problème de restauration, restauration et numérique, Écoutez les, regardez les, elles ont été captées en vidéos on peut les voir, Vous trouverez pas mal d’informations, alors il y en a qui en parle sur le plan très technique, d’autre sur un plan plus culturel, plus philosophique,, mais vous aurez différents points de vue sur ça, Et puis je vais vous envoyer le texte de Marie Frappat.
Marina GRAESEL – Du coup, comment on choisi les films à restaurer et ceux qu’on laisse de côté ?
Dimitri VEZYROGLOU – Alors ça c’est un vrai gros problème, parce que c’est le choix de l’ayant-droit en réalité, c’est le choix de la personne qui détient les droits sur la copie. On ne peut rien faire sans lui, on ne peut pas entreprendre une restauration sans l’ayant-droit. De deux choses l’une, soit la copie est libre de droits et dans ce cas là, c’est la personne ou l’institution qui détient la copie qui choisit en fonction de l’intérêt du film, de sa valeur pour l’histoire du cinéma, de sa rareté aussi parce que y’a ça aussi, le film étant reproductible : d’un même film, vous pouvez avoir des copies diverses mais parfois il arrive que ce soit une copie unique, qu’il y est une cinémathèque dans le monde qui conserve une copie d’un film que personne d’autre n’a. Là, la sauvegarde évidemment et même la restauration s’impose dans le sens où c’est un objet qui acquiert un caractère un peu unique, mythique voilà, et puis précieux parce que c’est l’unique exemplaire. Après sinon c’est la valeur esthétique du film qui est a jugé un peu arbitrairement, enfin pas arbitraire mais subjectivement. Il y a également la valeur historique du film, sa place dans l’histoire du cinéma, ce qui peut effectivement nous apporter comme nouveau regard sur l’histoire du cinéma, si c’est un film que l’on ne connaissait pas. Les menaces aussi qui pèsent sur ce film de dégradations supplémentaires, y a des films qui commencent à se dégrader mais qui en sont pas au stade où en sont d’autres, qui sont vraiment, si on n’attend un peu, on est sur qu’on va les perdre et qu’on va les perdre totalement. Il y a pleins de critères qui viennent se…, enfin y a pas quelque chose de systématique à ma connaissance. Sauf lorsque l’on a à faire à un financement public ou au moins partiellement public. Alors là, c’est le cas de la France, enfin pour le plan Nitrate et ce qui a succédé au plan Nitrate, parce que là pour le coup c’est de l’argent public, donc c’est évidemment contrôlé. Donc en même temps que le plan Nitrate, a été mis en place une commission, que l’on appelle la Commission du Patrimoine, et qui réunit des représentants du CNC, des représentants de chacune des grandes cinémathèques et des institutions de conservation de films en France et des historiens du cinéma, enfin au moins un historien du cinéma. Qui lui n’a pas d’intérêts particuliers, sauf son expertise sur l’intérêt de tel ou tel film. Parce que sinon, chaque cinémathèque arrive avec sa liste en disant « Bah celui là, il faut absolument le restaurer… », sauf que l’enveloppe ne suffit pas pour tout le monde et donc il faut faire un choix. Et ce choix là, il est transparent, au sein d’une commission, etc… Mais en dehors de ce cas là, bah c’est vraiment le choix de l’ayant-droit et en fonction aussi de ses moyens bien sûr, parce que la restauration ça coûte.
Marina GRAESEL – Oui justement, ça coûte combien a peu près de restaurer un film ?
Dimitri VEZYROGLOU – Alors ça j’ai peut être un élément de réponse, parce que j’ai pris des notes là dessus pendant un cours. Alors ça c’est une question, enfin je pense que celle qui pourra vous donner une réponse sûre ça sera plutôt Béatrice de Pastre, parce qu’elle elle voit passer tout ça évidemment et justement comme elle était intervenue dans un de mes cours, j’avais pris au vol des notes sur ça. Il faut juste que je les retrouve. Ah voilà ! 80 000 euros environ. C’est pas rien. Sachant qu’évidemment du coup après, il y a le problème de se faire rembourser. Parce qu’évidemment, ça ne peut pas être une mise à fond perdue, donc les gens cherchent à se faire rembourser. Or, là par exemple, 80 000 euros, c’est trois passages sur Arte. Trois passages sur Arte ! Combien de restaurations obtiennent trois passages sur Arte ? Par contre Ciné +, trois passages c’est 6 000 euros. Cela veut dire qu’il faudrait trente passages sur Ciné + pour rembourser une restauration. Alors évidemment, c’est pas le seul mode de diffusion, y a le DVD, y a la salle aussi, mais bon fabriquer un DVD ça coûte aussi de l’argent ; distribuer en salle ça coûte aussi de l’argent, il faut payer la promotion… Donc en définitive, c’est pas facile d’amortir une restauration. Les gens ont un peu ce mirage du marché du patrimoine qui, il est vrai a explosé ses dernières années, mais ça reste toujours pas quelque chose de rentable à coup sûr, ça non, ça c’est sûr.
Marina GRAESEL – Et ce serait peut-être justement, ce pourquoi TF1 ou Studio Canal se permettent de faire certaines modifications pour rendre les films plus attrayants, plus aux goûts du jour…
Charlotte DA CUNHA – …c’est pas la même démarche de base parce qu’un organisme publique comme le CNC par exemple, c’est vraiment une volonté de restauration, vraiment de l’objet brut donc c’est plaire au public avant de penser à l’aspect du film ?
Dimitri VEZYROGLOU – Bien sûr il s’agit que ça marche et donc il faut absolument être sûr que l’on va se rembourser et parfois ca entraine des comportements qui sont pas… enfin qui sont limites, en tout cas il faudrait discuter, réfléchir, etc, mais y a des gens qui discutent pas et qui réfléchissent pas. Ils vont choisir de toute façon, les moyens qui vont permettre de récupérer et rentabiliser le produit.
Marina GRAESEL – Et je sais pas pourquoi, mais je trouve ça assez fou qu’il n’y ait pas quelque chose qui dise qu’on doit préciser qu’il y a eu des modifications, qu’à la limite c’est pas une restauration mais une réinterprétation à la limite, rien n’existe à ce niveau là ?
Dimitri VEZYROGLOU – Alors il y a très souvent un carton qui annonce « Ce film a été restauré, en telle année, par tel laboratoire, etc » mais bon…
Charlotte DA CUNHA – …c’est pas obligatoire, c’est pas formalisé ?
Dimitri VEZYROGLOU – Non, non, c’est pas du tout systématique. Et effectivement, rien ne vous y oblige mais ça, c’est le droit du patrimoine cinématographique qui est fait de telle manière que, l’ayant-droit a tout pouvoir en réalité sur la copie tant qu’il détient les droits.
Charlotte DA CUNHA – C’est presque à se dire que la « bonne » restauration d’une œuvre, ça dépend de la personne qui la détient ?
Dimitri VEZYROGLOU – Et bien en grande partie oui, en grande partie oui. Parce que là, elle racontait aussi qu’il y a l’exemple de Tess, mais elle racontait aussi l’ayant-droit de Marcel Pagnol qui conservait vingt minutes de film qui ne sont pas et qui n’ont jamais été dans le film. Qui n’ont jamais été intégré dans le film, qui avaient été tourné et que lui détient, et qu’il veut à toutes forces, ajouter dans la restauration de César, le dernier des films de la trilogie de Marcel Pagnol. Alors qu’on fasse un bonus DVD avec éventuellement, etc… mais les intégrer à la version, alors qu’ils n’ont jamais fait partie du film, ça ouvre la voie à tout et n’importe quoi dans ce cas là. Donc les organismes ont ici, le CNC etc, résistent tant qu’ils peuvent, temporisent etc, mais …
Charlotte DA CUNHA – C’est plus de la négociation au final parce qu’ils n’ont pas le pouvoir dessus ?
Dimitri VEZYROGLOU – Voilà. Comme ça c’est passé aussi avec un film qui s’appelle Le Joli Mai, et elle pourra vous en parler Béatrice parce que ça a été assez douloureux, où les deux principaux auteurs, qui sont Chris Marker et Pierre Lhomme, étaient encore vivants, bon Chris Marker est mort depuis, mais il était encore vivant au moment de la restauration. Non seulement, il voulait intervenir sur la restauration, y compris en coupant des scènes, parce que le film est très long et puis c’est plus la peine etc… Alors que c’est un film en plus documentaire sur la France de 1962, avec une richesse documentaire extrêmement forte, et tout un aspect politique, parce que c’est juste à la fin de la guerre d’Algérie donc y a pleins de signes en fait… bon bref. Et Marker voulait couper tout ça. Ce qui est très lié à la guerre d’Algérie, alors que c’est un des points forts du film mais bon, et non seulement il voulait intervenir sur le film mais en plus ils étaient pas d’accord entre eux. Ils n’étaient pas d’accord sur ce qu’ils voulaient couper, donc c’était un cauchemar, pourtant je la connais depuis de nombreuses années Béatrice, et je la voyais quand elle était en plein restauration de ce truc c’était… elle était au bord de la dépression nerveuse (rires), parce que vraiment, elle était prise entre deux feux. Elle elle voulait restaurer la copie qu’elle avait, et avec ses deux auteurs qui étaient là « Ah non non ça on va couper », « Ça ça n’a aucun intérêt… » et elle elle était au milieu « Il faut protéger le film qui est sorti tel quel (rires) s’il vous plaît ». Elle a pas totalement obtenu gain de cause quand le film est sorti avec des coupures exigées par les auteurs.
Marina GRAESEL – Et donc j’imagine que c’est pas possible de faire une copie, enfin une restauration originale, une restauration changée de part les moyens financiers ?
Dimitri VEZYROGLOU – Oui à cause des moyens financiers, ça double les coûts. Il garde quand même une sauvegarde du matériel d’origine, mais les parties non-intégrées ne seront pas intégrées à la partie restaurée.
Annexe 3 : Entretien avec Marie Frappat – 15/11/18
Marina GRAESEL – Pouvez-vous vous présenter, reprendre votre parcours et ce qui vous a amené à vous intéresser au cinéma ?
Marie FRAPPAT – Oui, alors moi je suis maître de conférence en études cinématographiques à l’Université Paris Diderot. Et quel a été mon cursus ? Alors j’ai d’abord fait des études littéraires générales, puis des études d’italien qui m’ont menées finalement à travailler sur, à bifurquer en fait au moment de mon DEA que j’ai fait sur les institutions de conservation du patrimoine cinématographiques en Italie parce que j’avais la passion du cinéma depuis bien longtemps et puis la passion de trouver des cassettes vidéos, d’aller voir des vieux films, etc. Donc j’ai fait voilà un pont entre mes études d’italien et mes études de cinéma par le biais de ce mémoire de DEA que j’avais fait avec Jean Gili et ensuite dans mon travail de thèse je me suis intéressée à la restauration des films et à l’histoire de la restauration des films. Mon DEA était plutôt un travail sur la situation actuelle en fait du patrimoine, en Italie, et dans le cadre de ma thèse j’ai adopté une approche beaucoup plus historienne en fait. C’était à l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle sous la direction de François Thomas et j’ai un peu changé de type de démarche, je me suis intéressée donc à l’histoire de la restauration des films et à la façon dont la notion de restauration a émergé dans le champ du cinéma. Au début je voulais plutôt m’intéresser aux 30 dernières années, en gros depuis les années 1980-1990 puis jusqu’aux années 2010 un peu près. J’ai commencé la thèse il y a longtemps et finalement j’ai un petit peu changé de fusil d’épaules, donc je voulais aborder la question du passage au numérique en effet comme étant une période centrale et finalement je me suis intéressée à tout ce qui était antérieur à cela et donc antérieur aux années 1980 essentiellement. Et donc j’ai soutenu ma thèse qui s’appelle “L’invention de la restauration des films” en 2015, et donc actuellement, j’ai donné des cours à ce sujet, j’ai toujours pratiqué les différents festivals internationaux de films restaurés, j’ai côtoyé le monde des cinémathèques sans en être, enfin sans travailler dans les cinémathèques, mais donc en ayant toujours cette position un petit peu d’observatrice mais à la fois très très proche du monde des cinémathèques, mais en étant un petit peu extérieure, j’ai eu un regard un petit peu extérieur sur tout ça. Et donc je donne des cours à ce sujet depuis longtemps que ce soit sur la conservation des films ou plus spécifiquement la restauration, les différentes versions des films, etc. Et actuellement je suis en cinéma à Diderot.
Marina GRAESEL – Et du coup nos questions seront peut-être un peu naïves et un peu larges mais c’est pour essayer de dresser un portrait. Donc qu’est-ce que signifie en fait le terme de restauration numérique ? Quelle est sa vocation ? Son utilité et plus techniquement, si vous savez, comment fonctionne le processus ?
Marie FRAPPAT – Donc le terme restauration numérique ? Les deux ensemble ? Alors en fait il y a énormément de choses en réalité qui existent, qui sont très très variées sous l’appellation, plutôt appellation restauration numérique. Ça va en fait du simple transfert d’une pellicule d’un film qui est sur 35 mm ou sur pellicule de 16 mm sur pellicule, en fichier numérique avec un léger nettoyage par exemple des poussières et des rayures. Donc ça c’est avant tout du transfert en fait jusqu’à une réalité bien plus complexe qui nécessite en fait dans le processus de restauration de ne pas simplement transférer une bobine de film en fichier numérique qu’on pourra lire sur un ordinateur, sur un écran, un projecteur numérique, etc, mais des réalités plus complexes qui nécessitent de rassembler toutes les versions existantes d’un film, de comparer toutes les versions, de répertorier toutes les variantes, d’aller faire des recherches en bibliothèque, en archives, etc, pour documenter les différentes versions, choisir quelle version on va restaurer, à quelle version on veut aboutir et donc en effet après ou pendant la question du transfert et du nettoyage est aussi présente mais là, dans ce type de projet de restauration beaucoup plus complexe, le travail est beaucoup plus long, il est aussi à la fois un travail de recherche, un travail éditorial aussi, le remontage du film et un travail scientifique. C’est un peu les deux extrêmes quoi.
Charlotte DA CUNHA – Qu’est-ce qui conditionne le choix d’une version plutôt qu’une autre ? À travers les recherches qu’on va faire pour sélectionner la version qu’on va restaurer, qu’on va mettre en avant, qu’est-ce qui conditionne justement qu’on ait choisi cette version plutôt qu’une autre ? Est-ce qu’il y a des critères un peu établis ?
Marie FRAPPAT – Ça dépend du film, ça dépend du projet de restauration, ça dépend de la finalité de la restauration, ça dépend des commanditaires de la restauration. Les laboratoires par exemple, il y a différents types de laboratoire, il y a des laboratoires qui font, qui ne sont pas spécialisés dans la comparaison des films, etc. Il y a des laboratoires qui font de simples transferts, les laboratoires ils sont plutôt là pour exécuter, ils font des devis. Et puis après c’est le client, en fait, qui dit ce qu’il veut, après ça dépend de la ressource, parce que tout le travail, vraiment le processus de restauration complexe sont très très longs donc très coûteux en temps, ça demande de mandater des experts qui vont faire des recherches, parfois très longues et infructueuses aussi dans le marché des bibliothèques ou ailleurs, qui partent aussi, se déplacent un peu partout dans le monde ou alors parfois on fait venir des copies d’un peu partout dans le monde à travers le réseau de la Fédération Internationale des Archives du Film. Tout ça a un coût et donc ça dépend du client, de ce qu’il veut. Est-ce qu’il veut simplement ressortir le film sur écran sans se poser de questions sur l’histoire du film ou est-ce qu’il veut au contraire, est-ce qu’il estime que l’histoire du film a été complexe, qu’elle a été, que telle version a été présentée au public à tel moment, mais que ce n’était pas la version voulue par l’auteur, ou inversement est-que la version voulue par l’auteur en fait c’est pas une version historiquement, elle a pas été vue par le public quand elle est sortie, elle n’est pas de la même heure. Quelle est la bonne version à restaurer, il n’y a pas de réponse définitive.
Charlotte DA CUNHA – Justement cette question de la bonne version à restaurer, est-ce que c’est quelque chose qui fait débat, qui pose des questions aux professionnels du milieu ?
Marie FRAPPAT – Bien sûr parce qu’ il y a aussi, encore, une autre version, qui se diffuse et se pratique notamment sur les films récents, quand les auteurs sont encore en vie, qui ressortent aussi très souvent sous le label restauration, mais en fait ce sont des remontages, ou des nouvelles versions du film, par exemple. C’est normal, si vous relisez des choses que vous avez écrites il y a 5 ans, vous allez trouvez que telle ou telle phrase était pas bien écrite, etc, que votre paragraphe il irait mieux là, que votre paragraphe il est trop long, ben là c’est pareil. Les réalisateurs quand ils reviennent sur, quand ils revoient leurs films, alors parfois c’est de toutes petites modifications, qui sont imperceptibles, alors ça peut être raccourcir une séquence, raccourcir un plan, changer le…, ne pas faire le mixage, parce que à l’époque le réalisateur voulait que tel son soit mieux entendu mais les copies de l’époque ne permettaient pas de faire en sorte qu’elle soit bien entendue. Donc là en fait on transforme le film. On crée une nouvelle version. C’est un petit peu le cas extrême, si l’on veut, des versions refaites, remises au goût du jour. C’est quelque chose, ça fait bien sûr débat, puisque là on s’écarte, le film qui ressort n’est pas le film de 1961, enfin voilà, du film qui a été vu dans la forme.
Marina GRAESEL – Mais dans ces cas là du coup c’est la dernière version restaurée “qui compte” et qui sera commercialisée, vu, uniquement, ou est-ce que l’ancienne est toujours disponible d’une certaine façon ?
Marie FRAPPAT – En général c’est ça le problème, d’une certaine façon, enfin le problème, en tout cas pour les historiens comme nous, c’est que, en général, la dernière version restaurée l’emporte sur toutes les autres et la circulation d’une nouvelle version restaurée, alors entre guillemets, puisque plutôt nouvelle version on va dire, l’emporte sur toutes les autres et vient masquer, vient rendre inaccessibles les anciennes versions. Que ce soit à la circulation auprès du public, mais aussi auprès des historiens, auprès des chercheurs, et même aujourd’hui il arrive que certaines cinémathèques par exemple, vous savez les cinémathèques elles projettent des films, elles ont aussi des collections, elles s’occupent de collections. Donc elles veulent montrer leurs collections, ce qu’il y a dans leurs archives, dans leurs stocks et il arrive très souvent que certains ayants droits refusent que les cinémathèques projettent leur copie, leur copie du film, parce que soit il y a eu une nouvelle restauration, qu’ils préfèrent que ce soit cette nouvelle restauration qui soit diffusée, soit parce qu’il y a une nouvelle restauration en cours et que ils veulent, d’une certaine façon un embargo, le terme est peut-être un petit peu fort, un embargo sur, enfin, quand la restauration, quand elle est envisagée, enfin quand elle est en cours, ça peut tout à fait arriver qu’un ayant droit refuse la diffusion d’une ancienne copie.
Marina GRAESEL – C’est drastique comme mesure.
Marie FRAPPAT – Ben ce sont, voilà, des visées commerciales. J’ai oublié juste, dans ma bio, de dire que je m’occupe aussi d’un séminaire à l’école des Chartes avec Christophe Gauthier, Natacha Laurent, Ophir Levy et Dimitri Vezyroglou sur le patrimoine et la patrimonialisation du cinéma, donc on essaye collectivement de travailler en groupe sur ces questions là. En groupes de recherches quoi.
Marina GRAESEL – Et d’ailleurs sur la question du patrimoine, pourquoi pensez-vous qu’en ce moment il y ai une recrudescence d’intérêt pour le patrimoine ?
Marie FRAPPAT – Pourquoi ? C’est une bonne question, parce qu’en fait, alors moi je connais pas les questions économiques, vraiment je les ai pas travaillées, enfin je suis pas économiste, donc je, j’ai pas accès aux comptes de grandes maisons qui ont acheté des grands catalogues, etc, mais, c’est à dire, il y a quelques années je vous aurais dit qu’il y avait sans doute un profit tiré de ces nouvelles restaurations, de cette nouvelle circulation, de l’édition DVD, de tout ça, de les ressortir etc. Il y a même, il y a quelques années, il y a même Gaumont qui avait ouvert Les Fauvettes sur l’avenue des Gobelins, donc un cinéma spécialisé dans les films de patrimoine, qui ne montrait que des films de patrimoine, UGC avait une cale aussi réservée au patrimoine. Et là j’ai l’impression en fait que ben finalement ça n’a pas marché. Les Fauvettes est devenu un cinéma normal, les cinémathèques, après il y a des diffusions en cinémathèques qui font du profit, elles ont normalement un travail à but non lucratif. Donc c’est peut-être, voilà, le spectre de la VOD, de la circulation du film en VOD qui justifie tout ça, et puis il y a un grand effort de l’État aussi, qui a investi beaucoup d’argent via le Grand Emprunt qui a permis de soutenir un certain nombre de projets de restauration. Mais il me semble qu’à part Les Tontons Flingueurs et quelques films comme ça marquants, qui peuvent effectivement être offerts à Noël en Blu-Ray à un certain nombre de personnes, il faudrait, il me semble que finalement c’est pas, c’est peut-être pas si lucratif que ça… comme business. Mais voilà, moi je manque de données économiques.
Marina GRAESEL – Et du coup pourquoi pensez-vous que l’État ait décidé par exemple de lancer le Plan Nitrate ?
Marie FRAPPAT – Alors il y a eu plusieurs plans, c’est une bonne question, c’est difficile de s’y retrouver dans les différents plans de l’État. Le Plan Nitrate a été lancé dans les années 1990 pour transférer, donc vous savez que le film nitrate c’est un film qui brûle, qui est soumis à des compositions qui peut brûler très très facilement et de façon irréversible, on peut pas éteindre les incendies du nitrate. Et donc on pensait dans les années 1980 que les films nitrates au bout de 50 ans allaient mourir. En fait on se rend compte que quand ils sont bien conservés et qu’ils ont été bien traités pendant toute leur histoire, etc, certes, certains se décomposent, mais dans l’ensemble on peut continuer de les conserver en l’état. Les films Lumière par exemple, les originaux existent toujours 120 ans après. Mais donc on pensait dans les années 1980 que c’était irréversible et les films nitrates allaient tous se décomposer et être détruits, c’est vrai qu’il y avait beaucoup de bobines, de bandes à l’époque qui se décomposaient, qui devenaient à l’état gluant, de poussière, etc. Et donc l’État Français, enfin c’était pendant la politique de, c’était Jack Lang qui était à la culture, a décidé donc de lancer un grand plan, un grand plan pour sauver tout ce patrimoine, et faire donc des transferts de ces films nitrates sur, non pas en numérique parce que c’était pas encore utilisé à l’époque, mais de transferts de films nitrates sur des supports de sécurité, donc sur des pellicules qui étaient des pellicules dites “safety” donc acétate ou polyester, bon en fait elles aussi elles étaient, enfin on s’est rendu compte qu’elles se dégradaient aussi. Donc il y a eu énormément d’argent qui a été investi par l’État pour sauver le patrimoine cinématographique. Et c’étaient des transferts qui ont été faits notamment au CNC. Puis il y a eu là encore, soit c’étaient des simples transferts, soit c’étaient des processus de restauration plus complexes comme je vous l’ai dit tout à l’heure avec des comparaisons de copies, etc. Ce qu’il y a eu plus récemment, c’est le Plan de Numérisation et de Sauvegarde des Films Anciens, un grand plan dans les années 2010/2015, je me souviens plus des dates là par contre je suis désolée. Un grand plan de numérisation des films anciens, en partie financé par l’État, par divers biais, vous pouvez trouver tout ça sur le site du CNC, il y a différents documents relatifs à ça. Il y avait plusieurs raisons à ça, il y avait déjà la transition numérique qui était, voilà, bien entamée, et donc, en fait, à terme c’est toujours la pellicule qui sera plus stable que le numérique, mais il y avait cette idée que fallait tout mettre en numérique, et puis c’est aussi arrivé à un moment de grande crise chez les laboratoires de pellicules, donc il y a eu un petit peu cette idée d’essayer de trouver un moyen que l’activité de certains laboratoires perdure malgré tout, même si, parce qu’il faut imaginer que les laboratoires tiraient quotidiennement des milliers et milliers de mètres de pellicules et il y a eu une énorme crise, toute la chaîne de diffusion des films a été convertie au numérique, il y avait plus de raison de tirer de pellicules, donc de grands plans de licenciement de laboratoires, et donc le plan de numérisation des films anciens c’était aussi une façon de trouver du travail, de donner du travail à ces laboratoires en crise, certains qui continuaient d’exister malgré les remaniements. Et puis ben l’idée c’était aussi de faire, de continuer à faire circuler les films du patrimoine, alors là dans ce plan de numérisation des films anciens, des films du patrimoine, c’était avant l’an 2000, donc voilà des années 1990 c’était aussi considéré comme tel, l’idée de continuer à les faire exister sur les écrans à un moment où il y avait presque plus d’écrans, en tout cas les écrans commerciaux étaient quasiment tous convertis au numérique, donc les projecteurs dans les salles étaient numériques, et il y avait eu un énorme soutien en fait de l’État là aussi à la transition des salles vers le numérique.
Charlotte DA CUNHA – Justement par rapport à ces outils numériques, enfin ces supports numériques qu’on a actuellement, vous avez dit justement qu’ils étaient plus instables au final que les pellicules, qu’est-ce qui fait que c’est plus instable et que, en gros qu’est-ce qu’est la limite de ces outils numériques que l’on utilise actuellement ?
Marie FRAPPAT – Alors, dans les outils numériques il y a différentes choses, les outils numériques, enfin je sais pas si c’est ce que vous entendez, mais les outils numériques qu’on utilise dans la restauration qui sont des outils, qui sont à la base, qui ont été à la base conçus pour la post-production en fait, pour les effets spéciaux, ce genre de choses, et ces outils ont été donc appliqués à la restauration des films pour enlever les poussières, recréer les images manquantes, recréer des portions d’images aussi, dégradées. Donc là il y a un, il y a toute cette partie là qui évolue, le système qu’il faut rééquiper constamment. Après il y a tout ce que permet de faire le numérique qui était impossible de manière très partielle en photochimique. Après il y a la question, une autre question, qui est pas celle des outils numériques, qui est celle des supports, c’est à dire que les…, voilà la pellicule, on sait que, stockée dans de bonnes conditions, mise sur des étagères dans de bonnes conditions d’humidité, de bonne température, je sais pas si vous avez été au CNC pour voir ce genre de choses, mais bon, on sait qu’elle peut durer un certain temps. Les fichiers numériques, c’est un petit peu comme tous les fichiers, on sait pas combien de temps on va pouvoir les lire, certains, après ça dépend des supports mais vous avez peut-être des DVD des années 2000 que vous arrivez plus à lire aujourd’hui, soit parce que le DVD est dégradé, soit parce que, alors, c’est peut-être pas le cas des DVD, ou alors, certains supports numériques, on a plus les machines qui permettent de lire ces supports et puis le numérique il faut…, c’est pas fixe, c’est à dire que vous ne mettez pas un disque dur sur une étagère et puis 20 ans après vous le reprenez et vous retrouvez les données. En réalité, déjà à priori vous retrouvez pas trop les données, il y a toujours des problèmes de corruption de données. Et puis, surtout, il faut…, il faut faire des opérations, des transferts, là aussi des migrations de données, régulières, tous les 3-4 ans migrer les données pour être sûr qu’elles soient toujours accessibles. Donc c’est une question vraiment très très complexe. Je vous invite à ce sujet peut-être à regarder, pour votre dossier en général, c’est une journée d’étude qui date d’il y a quelques années déjà mais allez sur le site de la Cinémathèque Française, ils ont, ils avaient organisé, je sais plus comment elle s’appelle…, est-ce que c’était la révolution numérique, je sais plus, mais ils avaient capté la journée, toutes les interventions de la journée, c’était peut-être en 2012…, c’était il y a quelques années déjà quand même. Et si l’avenir…, non je sais plus…, et si le cinéma perdait son…, C’était quoi le titre… ? “Et si le cinéma perdait sa mémoire?”, à vérifier.
Charlotte DA CUNHA – Du coup peut-être partir maintenant un petit peu plus avant le numérique et ce qu’il se faisait avant, avoir un petit aperçu justement de cette transition, parce que là pour l’instant on est un peu concentrés sur l’après.
Marie FRAPPAT – Alors avant, donc il y avait cette question de…, cette inquiétude sur les pellicules nitrates, donc il y avait…, il y a eu beaucoup, dans beaucoup de cinémathèques, que ce soit dans le cadre de grands plans comme le Plan Nitrate en France ou quelques fois de manière plus ponctuelle, des transferts de films nitrates vers acétate ou vers polyester, et ça à l’époque on appelait pas ça restauration, c’était vraiment plutôt des transferts ou des sauvegardes, et donc il y avait tout ce processus là mais qui pouvait nécessiter des ajustements dans les laboratoires au niveau des tireuses, au niveau des machines, au niveau de…, enfin qui n’étaient pas de simples transferts…., pas forcément de simples transferts, ça pouvait être…, ça pouvait nécessiter une vraie expertise, de la part des restaurateurs, qui devaient ajuster les machines, ajuster le cadre, c’était pas simplement on met une bobine, on appuie sur le bouton, et puis on fait un tirage continu automatique et après on a notre nouvelle bobine. Ça pouvait être fait image par image, donc ça pouvait demander aussi énormément de temps, ça pouvait être fait sur des pellicules très dégradées par exemple au niveau des perforations, donc il faut aussi choisir le type de tireuse adapté qui va pas éclater les perforations, fallait réparer les perforations, réparer les déchirures, donc il y avait un certain nombre de choses que l’on pouvait faire déjà à l’époque sur la pellicule, il y a aussi différents types de…, sur la question du…, j’imagine que le numérique permet d’enlever toutes les poussières, toutes les déchirures, etc, il y avait déjà certaines techniques, alors, peut-être moins efficaces mais à l’époque du photochimique qui permettait de diminuer les rayures, par exemple le tirage par l’immersion, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait déjà ce genre de choses qui permettaient de diminuer les rayures, diminuer les poussières aussi en tout simplement nettoyant la pellicule, la faisant passer dans des machines qui permettaient d’enlever un certain nombre de poussières. Et puis il y avait aussi ces différents processus de…, qui consistaient à rassembler toutes les copies des films, à les comparer, à les collationner. Les premières grandes restaurations comme…, il y a eu avant, mais comme les premières marquantes, en tout cas dans le monde culturel, c’est à dire Napoléon et Métropolis, datent de l’époque photochimique. Elles ont été menées, Napoléon par Kévin Brownlow qui était passionné du film Napoléon d’Abel Gance, qui a fait tout ce qu’il pouvait pour récupérer tous les bouts de pellicules qu’il pouvait rassembler et faire, alors à l’époque on imaginait que la restauration c’était faire la version la plus longue possible. Pendant longtemps c’était un peu le graal de la restauration, trouver les nouvelles séquences invisibles d’une part et les insérer, en fait bon, peu à peu on s’est rendus compte qu’en fait ça créait aussi des monstres qu’il fallait peut-être aller voir plus concrètement quelle était la version la plus judicieuse à restaurer, qu’elle correspondait à la sortie en 1927 dans tel cinéma ou est-ce qu’elle correspondait au premier montage du réalisateur, il fallait choisir quoi, c’est pas forcément tout remettre bout à bout, je caricature un petit peu. Et après en fait ce qu’il s’est passé dans les années 1990…, au milieu des années 1990 un peu près, on a commencé à utiliser le numérique et les outils numériques dont je parlais tout à l’heure, mais seulement pour des portions de films, des portions de films vraiment sur lesquelles le photochimique ne pouvait pas marcher ou alors pour des films très courts, par exemple des portions de films où il y a eu vraiment des déchirures très complexes ou une décomposition aussi…, complète de l’image. On transférait en fait, en numérique, en quelques images, on les re-travaillait et ensuite effectuait un shoot, ce qu’on appelait un shoot, enfin on reportait sur pellicule les fichiers numériques et on insérait le bout de pellicule, j’exagère un petit peu aussi, la séquence, la partie, le morceau sur lequel on avait travaillé dans le film.
Marina GRAESEL – Donc il y avait une époque où le numérique et la photochimie était couplée.
Marie FRAPPAT – Oui, c’est ça.
Charlotte DA CUNHA – Est-ce que c’est encore le cas aujourd’hui ou est-ce que le numérique a pris le dessus ?
Marie FRAPPAT – Alors, aujourd’hui, il y a eu plusieurs tendances, il y a eu ce moment où le numérique était un simple outil pour faire la restauration et faire vraiment des morceaux de restauration comme ça, ensuite il y a eu une période où vraiment il y eu des restaurations numériques et des restaurations photochimiques, un petit peu parallèlement, depuis les années 2000 je dirais, la plupart des restauration se font sur…, enfin se font en numérique, après il y a différents systèmes, enfin, il y a, comment dire…, il y a encore quelques cinémathèques qui travaillent exclusivement sur pellicule et qui font des tirages de copies et qui font des teintages à la main, commandés dans tel ou tel laboratoire, mais c’est vraiment pour des films muets avec des diffusions vraiment très limitées. Je dirais que toutes les restaurations de la Gaumont, elles se font en numérique. Après dans le cadre par exemple du grand emprunt il y avait une exigence qui était malgré tout que…, il y ait après la restauration un report sur film du fichier numérique, pour que le film puisse…, qu’il y ait des bobines que l’on puisse conserver. Là, je pense que maintenant, c’est plus le cas, aujourd’hui on ne tire plus systématiquement de copie film à l’issue d’une restauration. Par contre à l’inverse ça peut, et ça ce sont des frémissements qui sont, je pense, arrivés depuis 2-3 ans, à l’inverse il y a aussi un retour un petit peu du fétichisme de la pellicule et le tirage d’une copie film, à partir d’un fichier numérique peut devenir un argument commercial, un argument pour une ressortie dans une salle de cinéma. C’était Le Reflet de…, non c’était pas Le Reflet de Médicis, je sais plus, j’ai un doute sur la salle mais bon, il y a certaines restaurations par exemple de Max Ophüls, qui sont ressorties sur pellicule dans telle salle parisienne et ça avait un peu…, voilà…, le retour de la pellicule. Donc maintenant que le numérique a envahit tout, on a ces petites niches comme ça, de retour à la matière pelliculaire. Une dimension un petit peu fétichiste.
Charlotte DA CUNHA – C’est assez compliqué comme question, mais au niveau qualitatif, parce qu’il y a pleins de conditions différentes, mais qu’est-ce qui garantit le respect le plus proche du film initial ?
Marie FRAPPAT – Au niveau qualitatif, c’est aussi une chose que je vous ai pas dite mais le numérique, vraiment il y a tout derrière le numérique, vous pouvez avoir des résolutions, qui sont des résolutions, qui, comment dire … si vous faites un transfert de votre pellicule 35mm sur un fichier compressé, hyper compressé et que vous allez lire…, qui va être lu sur YouTube ou je sais pas où, vous allez, enfin ça va être un fichier numérique, mais ça va être un fichier de très très mauvaise qualité. C’est pas parce que c’est du numérique que c’est de la bonne qualité de visionnement, inversement c’est pas parce que c’est du 35mm, enfin c’est pas parce que c’est de la pellicule de 35mm que c’est de la bonne qualité, il y a des tirages qui sont très très mauvais, parce que la tireuse a été mal réglée ou alors il y a des copies qui sont vraiment très très dégradées avec énormément de rayures, et peut-être qu’il vaut mieux voir tel film dans une restauration 4K qui vous semblera un peu figée plutôt que dans cette copie qui a mal vieilli, donc voilà, et puis aussi dans le numérique il y a des différentes, il y a des restaurations en 2K, en 4K, en 8K, donc avec des résolutions différentes qui aussi permettent, enfin, qui donne ensuite une qualité de rendu, au moment de la projection, différente. Alors après certains y sont sensibles, d’autres ne voient absolument pas la différence, en fait très franchement la plupart des gens ne voient pas la différence. Mais voilà, certains quand même prétendent qu’il y a une différence. Après sur la question de la qualité, vous parliez plutôt de la question de la version, est-ce que c’est la bonne version qu’on…, ça il y a aucune façon de, aucune possibilité de trancher de manière nette sur cette question, la seule chose à faire, il me semble, pour ceux qui font les restaurations, pour les restaurateurs, ou pour les commanditaires des restaurations, pour les clients des laboratoires, c’est de dire ce qui a été fait et pas de dire si il y a eu des modifications, de documenter en fait la restauration, ça c’est le grand principe qui est diffusé au sein des…, enfin, dans le milieu des archives de films, en fait c’est de dire systématiquement ce qui a été fait sur la restauration comme dans le domaine de l’art, mais c’est un grand principe qui est, comment dire, qui est pas forcément appliqué, et puis qui est encore moins appliqué dans, déjà dans le domaine des cinémathèques et archives de films, il est pas forcément appliqué, mais alors dès qu’on en sort il l’est encore moins.
Marina GRAESEL – Et à quel moment, au point de vue de l’éthique, on peut penser que la version qui est sortie, d’un certain point de vue, on peut penser que la version n’est plus du tout la même mais qu’on a à faire à un objet totalement transformé, totalement. J’exagère un peu mais…
Marie FRAPPAT – En fait, je pense que quoi qu’il arrive, on a à faire à un objet totalement transformé. (rires) Parce que, bon, pour pleins de raisons. Alors il y a aussi un autre retour en ce moment, qui est le retour donc des projections sur pellicule, il y a certaines niches comme ça, dans certains festivals, qui sont réservés à des projections sur pellicules, il y a même certains festivals, enfin un festival en particulier qui a lieu à Rochester, donc à la Georges Eastman House, qui est un festival spécialisé dans la projection de films sur pellicule nitrate. En France donc c’est interdit, le nitrate il sort pas de Bois d’Arcy. Enfin il sort pour aller dans les laboratoires pour…, enfin pas dans le but d’être projeté, mais je dirais à part à Rochester où on va en effet aller voir telle copie qui date de 1938 de tel film sur pellicule nitrate, l’artefact original en fait, et encore, je dirais certes on voit cette copie, enfin cette copie est projetée mais ils essayent aussi de le faire dans les meilleures conditions possibles, alors je sais pas quels sont les projecteurs qu’ils utilisent mais est-ce que ce sont les projecteurs d’époque qu’ils utilisent ? C’est pas sûr. Est-ce que ce sont les lampes d’époque qu’ils utilisent ? C’est pas sûr. Et puis au delà de ça, donc il y a cette tentative de recréation de spectacle, de voilà, nouvelle projection du film d’origine, mais ça reste une salle moderne, des spectateurs modernes, des spectateurs d’aujourd’hui qui ont aussi des téléphones, enfin des smartphones, qui voient des vidéos sur ce, enfin… Les conditions générales de visionnement ne sont pas les mêmes, donc tout ce qui entoure aussi la vision du film, tout ce qui relève aussi du spectacle cinématographique dans l’ensemble, mais, a été transformé donc voilà…, même si on a accès à la copie la plus pure, et encore même la copie la plus pure, pour y aller, enfin il faut payer un billet d’avion, ce que j’aimerais bien faire un jour (rires) mais j’ai jamais eu l’occasion de le faire. Donc c’est réservé à, je sais plus combien il y a de places dans le cinéma, bon très peu de personnes quoi.
Marina GRAESEL – Est-ce que vous avez des cas, des exemples de cas où ça a été “particulièrement polémique” d’engager une restauration ? Ou plutôt le résultat de la restauration a été particulièrement polémique ?
Marie FRAPPAT – Alors il y en a eu beaucoup, et ça a fait plus ou moins de bruit, je dirais que le cas le plus, enfin ce qui a marqué en fait, les débuts des grands débats autour de la…, il y a eu énormément d’articles sur la déontologie de la restauration, l’éthique de la restauration, enfin ça vous pouvez allez lire dans le journal de la Fédération Internationale des Archives du Film, il y a eu beaucoup d’articles à ce sujet, il y a eu des articles de Raymond Borde, Vincent Pinel, et d’Enno Patalas depuis les années 1980 en fait, il y en a eu beaucoup, ce qui a marqué, enfin ce qui a été le point de départ de tous ces débats, ça a été un projet en particulier, qui était le, enfin ce qui a été présenté à l’époque comme la restauration qui était en effet plutôt une nouvelle version de Metropolis par le musicien Georgio Moroder qui a en fait…, qui a travaillé aussi, en même temps qu’un archiviste qui s’appelait Enno Patalas, sur le film Metropolis qui a compilé, enfin qui a essayé de rassembler un certain nombre de morceaux de Metropolis, mais qui en même temps aura complètement transformé le film puisqu’il a coupé tous les cartons. Les inter-titres, il les a transformés en sous-titres, parce qu’il disait que c’était trop lent, etc, mais en fait dans le film muet le carton c’est un plan en fait et comme, au même titre qu’un plan de visage ou quoi que ce soit, ça fait partie du film, ça fait partie aussi du rythme du film. Et puis il y a ajouté, il a colorisé en fait électroniquement à l’époque c’était des, il a colorisé les différentes séquences, alors que Metropolis est, alors il y a beaucoup de films muets qui étaient en couleurs, qui étaient teintés, virés, etc, mais pour le coup Metropolis était en noir et blanc. Donc là il a colorisé, électroniquement, et puis il a ajouté une bande sonore, une bande son, rock. Donc ça, ça a fait un peu scandale en fait à l’époque, ça a fait scandale dans le domaine des cinémathèques, ça a été en même temps un énorme succès public, le public a vu Metropolis, enfin, Metropolis n’aurait jamais été vu par tout ce monde là si il n’avait pas été retouché. Il n’aurait jamais recirculé, le film aurait été cantonné au cercle des archives quoi, des cinémathèques et archives. Donc là ça a été, en tout cas ça a été le point de départ de beaucoup de questionnements des archivistes, qui ont dit ben faut peut-être se poser la question de ce qu’on peut faire, de ce qu’on peut pas faire, ce qu’il est bon de faire.
Marina GRAESEL – Parce que du coup il y a peut-être une “remise en question” de ce que l’on peut faire, enfin ce que l’on aurait le droit de faire en restauration sous le couvert de vouloir plaire à un nouveau public, de pouvoir diffuser en fait ces choses-là ?
Marie FRAPPAT – C’est à dire ?
Marina GRAESEL – Est-ce que certaines personnes peuvent imaginer de s’octroyer le droit de transformer le film pour pouvoir le rendre accessible en fait ?
Marie FRAPPAT – Oui, ça c’est le grand débat en fait, c’est le grand débat, il y a aucune interdiction, enfin, à partir du moment où vous avez les droits sur le film, vous faites ce que vous voulez. Enfin vous faites ce que vous voulez, à la limite il n’y a pas de raison qu’on vous interdise aussi de faire ça à partir du moment où vous avez les droits d’auteurs, la simple chose à faire c’est vraiment de le dire quoi, de pas présenter ce film comme étant la version d’origine du film. Par exemple il y a une autre restauration qui a fait débat, beaucoup plus récemment, c’est la version du Voyage dans la Lune donc par Serge Bromberg et Lobster, alors qui a été extrêmement médiatisé donc le film aussi il fonctionne très bien, donc il a été revu par un certain nombre de personnes qui l’auraient jamais vu. Mais il a été présenté comme étant la version en couleur du Voyage dans la Lune alors qu’en fait il s’agit d’une version, déjà à l’époque, il y avait, le film a sûrement circuler, on a pas les copies, le film a sûrement circuler dans pleins de copies en couleurs différentes, on a jusqu’ici…, on retrouvait seulement les copies en noir et blanc, là dans les années, enfin dans les années 2000 on a retrouvé en effet une copie couleur du Voyage dans la Lune mais c’était une copie qui a circulé en fait qui était une copie espagnole, même à la fin du Voyage dans la Lune vous avez un drapeau d’Espagne qui enfin…, qui est pas…, enfin qui…, c’était certainement pas voulu dans l’espace français, c’est sûrement pas les couleurs qui avaient été adoptées, donc pareil à partir de là toutes les couleurs pouvaient être très très différentes d’une copie à l’autre, d’un certain coloriste à… Déjà dans le même atelier les couleurs pouvaient différer d’une copie à l’autre mais en plus pendant… selon les espaces de circulations, selon les ateliers, il y avait différents types de couleurs utilisées, et là pour le coup c’était très clairement une copie couleur faite dans le réseau espagnole, Lobster s’est servi de cette copie couleur pour restaurer tout le reste du film en couleurs, pour travailler avec un laboratoire aux États-Unis pour ça. C’est tout à fait justifiable comme projet, enfin si c’est expliqué, si c’est dit, etc. Par contre ce qui est plus problématique c’est le fait de présenter ça comme la version en couleur du Voyage dans la Lune, alors après c’est vrai que c’est, comment dire, au niveau de la communication, c’est plus facile de dire “La version”, c’est plus vendeur, c’est plus simple, mais c’est pas vrai. (rires)
Marina GRAESEL – Donc est-ce que vous croyez si c’est pas précisé c’est dans un but pécunier, peut-être de plaire à un public d’une certaine façon ?
Marie FRAPPAT – C’est dans un but de plaire, enfin, oui c’est à dire que si on veut faire de l’argent sur quelque chose il faut forcément essayer de plaire un petit peu et donc trouver les mots qui vont attirer le public en tout cas…, après c’est vrai que c’est beaucoup plus…, enfin là j’ai pris 3 minutes pour vous expliquer que ça passe pas sur une affiche de film donc. C’est une simplification du discours qui passe par ce type de …
Charlotte DA CUNHA – Au niveau international il y a pas de, enfin chaque pays a un peu sa façon de restaurer des films ou est-ce qu’il y a des similitudes ou des… ?
Marie FRAPPAT – Non je dirais que maintenant c’est vraiment très…, c’est des pratiques qui sont vraiment très internationales, on va, enfin la Cinémathèque Française va faire, et Gaumont, faire des restaurations en Italie ou au Portugal, les laboratoires sont un peu partout dans le monde, en plus, avec le numérique pour le coup il y a la possibilité aussi de faire circuler plus facilement les copies donc il peut y avoir des transferts de films qui sont fait à tel endroit et puis les fichiers sont envoyés à tel endroit, c’est à tel endroit qu’ils sont retravaillés, et puis ensuite ils sont diffusés un peu partout dans le monde, donc je dirais que quand même sur la question des versions et la question de la documentation, et il y a un autre principe qui est très mis en avant par les archives c’est le principe de la réversibilité, c’est à dire que si vous touchez à un film, si vous faites la restauration d’un film, il faut être sûr que l’on pourra revenir en arrière. Les techniques dans 10 ans auront évoluées, les personnes auront évoluées, les connaissances auront évoluées, on trouvera peut-être une autre copie. Metropolis en est l’exemple le plus fameux, on a retrouvé une copie en Argentine bien longtemps après un certain nombre de restauration qui avait déjà été faites, donc il faut pouvoir revenir en arrière, ça c’est aussi un grand principe qui est édicté dans les musées, dans le monde des musées, et donc ces différents principes, documentation et réversibilité, cette attention philologique en fait aux films, aux différentes versions, à leur…, tout ça a été quand même beaucoup travaillé par l’Italie, par le centre notamment de Bologne et puis par d’autres italiens mais bon ce sont des principes qui ont aussi beaucoup circuler dans les années 1990-2000 et qui sont, je pense maintenant, internationalement reconnus si ce n’est appliqués.
Marina GRAESEL – Juste rapidement, je me doute de la réponse, mais au niveau du droit, y’a rien en fait qui protège les films en soi, et c’est ceux qui possèdent les droits qui décident de ce qu’ils veulent faire ? Il n’y a pas de peine qui pourrait être envisagée éventuellement pour trahison de l’objet ?
Marie FRAPPAT – Non, non, non, c’est l’ayant-droit qui fait ce qu’il veut sur le film. C’est lui qui a les droits sur le film donc c’est lui qui dira, après ça peut être des sociétés qui possèdent des catalogues énormes…., c’est lui qui va dire au laboratoire ce qu’on va faire sur le film. C’est le commanditaire, c’est le client du laboratoire.
Annexe 4 : Entretien avec Béatrice De Pastre – 07/01/19
Charlotte DA CUNHA – Pour commencer, une présentation de votre parcours, de votre fonction, etc…
Béatrice DE PASTRE – Je suis Béatrice De Pastre, je suis la directrice des collections du CNC (Centre National du Cinéma et de l’image animée), directrice adjointe à la direction du patrimoine. Je suis ici depuis fin janvier 2007, auparavant j’ai été 16 ans la directrice de la cinémathèque Robert-Lynen de la Ville de Paris. Depuis maintenant bientôt 12 ans, je veille effectivement au traitement des collections, à la restauration, leur valorisation, leur conservation, etc… pour le CNC. Et je participe également aux différents dispositifs mis en place par le CNC, pour aider les ayants droits à la restauration et la numérisation de leur patrimoine.
Marina GREASEL – En terme de fourchette, combien coûte une restauration numérique ?
Béatrice DE PASTRE – Une restauration numérique, tout dépend de la difficulté du travail et de la longueur du film. Puisque les prestations sont en mètres ou en minutes, donc si vous avez un film de 6 heures, très abîmé des années 1920, ça va coûter très très très cher. Alors si vous voulez un ordre d’idée, le devis pour le Napoléon d’Abel Gance, donc 1928 est à 1 300 000 euros, enfin le devis initial que nous avons subventionné. Après un film des années 1980, de 90 minutes, ça coûte 90 000 euros à peu près. Après je pourrais vous donner des documents justement avec des moyennes, le bilan du dispositif mis en place par le CNC depuis juillet 2012, d’aide aux ayants droits sur leur catalogue. Des subventions ou des avances que nous faisons pour des restaurations numériques, là y a un coût moyen par film, comme ça ça vous donnera une idée un petit peu des chiffres, mais c’est à peu près autour de ça. À peu près 90 000 euros par film de 90 minutes. Alors il ne faut pas en conclure que c’est 10 000 euros les 10 minutes, mais il faut toujours prendre en compte le critère durée et le critère ancienneté, difficulté. Après il peut y avoir un négatif nitrate des années 1920 en très bon état et qui pose pas de problèmes et avoir une charpie des années 1960, mais un facteur matériel et un facteur durée qu’il faut prendre en compte.
Marina GRAESEL – Justement, quels sont les types de subventions qui sont mis en place pour aider les ayants droits ?
Béatrice DE PASTRE – Il y a deux types, deux façons pour le CNC d’être acteur dans ce secteur. Il y a d’abord cette aide à la numérisation et à la restauration qui a été mise en place en juillet 2012. C’est une aide donc nouvelle, que l’on a décidé, soumis à la commission européenne, étant donné que c’est une aide d’État. L’État apporte des financements à des structures privées, les ayants droits, donc ça vous savez que les aides d’État sont contrôlées par la commission européenne, on a pas le droit normalement, un État ne peux pas apporter son aide à une société privée, si ce n’est dans des cas bien précis, donc on a fait valider cette aide par la commission européenne et surtout l’intensité de notre intervention, qui peut intervenir jusqu’à 90% du montant du devis de l’intervention sur des films qui avaient un potentiel économique quasi nul. C’est-à-dire effectivement ce sont des films de patrimoine importants, mais des films qui à côté de ça ne permettront pas leur commercialisation en DVD, en diffusion TV, etc… de même rembourser le montant de la restauration. Donc ce dispositif a été validé par la commission européenne, donc à partir du mois de juillet 2012, nous avons donc pu intervenir. Un groupe d’expert a été constitué, un peu sur le modèle des commissions classiques du CNC, qui change régulièrement, qui après ça se déterminent sur le caractère patrimonial, l’urgence qu’il y a à soutenir tel ou tel projet, qui nous sont apportés par les ayants droits, ce n’est pas nous qui choisissons les films, c’est les ayants droits qui proposent des titres de films à restaurer et ses titres sont validés par le groupe expert. Le montant de la subvention ou de l’aide remboursable est également déterminé par ce groupe expert en fonction du dossier et de l’état des lieux du matériel qui est fourni dans le dossier de demande d’aide écrit par l’ayant droit. La seconde aide qui existe, c’est le CNC qui va intervenir de son propre chef sur ses collections, c’est-à-dire des films qu’il a à la gestion dans ses murs. C’est par exemple le film que nous avons présenté au dernier Festival de Cannes, Fad,jal… grand père, raconte nous… de Safi Faye, dont nous avions les négatifs et que nous avons choisi de restaurer, avec l’accord de la réalisatrice. Nous avons pris entièrement en charge la restauration qui s’est faite dans notre laboratoire, et nous avons signé une convention avec l’ayant droit, qui est également la réalisatrice.
Marina GRAESEL – Ce groupe d’expert il est composé de qui et comment ?
Béatrice DE PASTRE – De techniciens, d’historiens du cinéma, de diffuseurs, etc… Actuellement, la composition du groupe est publique. Vous avez, sous la présidence de Gilles Jacob, Michel Ciment, Jérôme Chung, Bruno Deloye, Pierre Gras, Jacques Kermabon, Natacha Laurent, Pierre Lhomme, Philippe Reinaudo, Michel Romand-Monnier et Laurent Véray.
Marina GRAESEL – Quelles sont les retombées économiques, s’il y en a, et à qui reviennent-elles ?
Béatrice DE PASTRE – Les retombées économiques reviennent aux ayants droits, puisque c’est eux qui assurent la valorisation de ce patrimoine. Alors des retombées économiques, il y en a plus ou moins. Il y a certains films qui ont eu une belle vie en salle, les films de Jacques Tati, Le Joli Mai, Paris Texas de Wim Wenders, etc… dans le document que je vous donnerais, il y a justement des chiffres des derniers films qui ont eu des ressorties en salle. À peu près un film sur deux qui ressort en salle a été financé dans le cadre de ce dispositif, puisque l’on va aider tous les films français, ou ayant une part de coproduction française. Donc il y a des films qui marchent bien, mais le box-office culmine à 30 000 – 40 000 entrées en salle, sur un an, un an et demi, ce qui est beaucoup par rapport à certains films neufs et frais qui sortent aujourd’hui, mais ce n’est pas non plus des millions d’entrées. Après vous avez des diffusions télé, car il y a quand même des films qui passent à la télé. La case Arte du lundi soir fonctionne bien, voir très très bien, avec plus d’un million de téléspectateurs et puis vous avez toutes les chaînes du câble, 6ter, Gulli, etc… qui font du film de patrimoine et à qui on ne pense pas, aller voir des films de patrimoine sur ces chaines là, mais elles diffusent des films en début de soirée ou dans l’après-midi. Il y a effectivement des ventes télé et pour un ayant droit c’est un apport important. Mais sans l’aide du CNC, cela ne couvrirait pas entièrement les frais de restauration. Après il y a les éditions DVD, la VOD qui n’est pas encore un modèle économique probant pour l’instant, cela le deviendra sûrement un jour, mais pour l’instant, ce que les cataloguistes récupèrent pour le moment de présence dans le bouquet d’abonnement et les plateformes VOD ne rapportent pas grand chose. Il n’y a pas vraiment de modèle économique, si vous voulez c’est vraiment des actions en faveur du patrimoine, si ce n’est qu’il y a quand même un marché, des ventes télé, DVD… Mais si vous voulez, ça a tendance à s’équilibrer grâce aux aides du CNC.
Marina GRAESEL – Est-ce que vous avez une idée de pourquoi certains films marchent mieux que d’autres une fois qu’ils sont ressortis ?
Béatrice DE PASTRE – C’est très aléatoire, mais il faut qu’il y ait une attente du public et que le film soit « vendu » de la même façon qu’un film frais, c’est-à-dire avec une affiche ou une campagne de presse, un dossier de presse. Exactement de la même façon un film qui est restauré, qui sort un mercredi dans une salle des Quartiers Latins, il a peu de chances d’être là en fin de semaine. Ça été le cas de Providence, d’Alain Règne qui est restauré et qui est sorti comme ça. Après vous avez des choses qui marchent très bien, Le Joli Mai de Chris Marker, qui a très bien marché, ça fait partie de mon « 33 000 entrées » mais par exemple le programme de court métrage avec le Dimanche à Pékin, Lettres de Sibérie, qu’il n’a quasiment pas eu d’existence en salle. Après vous avez l’ADRC (Agence pour le Développement Régional du Cinéma) qui fait un travail auprès des salles en Région, vraiment important et sur la durée, qui lui va, l’ADRC va l’accompagner, va faire des cycles, faire un matériel d’accompagnement, une affiche un document, affiches recto verso, qui va en même temps avec des informations qui peuvent aussi accompagner, qui pour les films de muet, qui va accompagner des ciné-concerts, a faire circuler des conférences, finance des petits avant de programmes, et ça va être quelque chose d’élaboré, on voit ce que c’est que la longue traîne si vous voulez, c’est que le film va sortir à Paris et va commencer à circuler trois mois plus tard en région et là, va avoir pendant 18 mois, avoir effectivement une vie dans les salles des petites et moyennes villes en région donc voilà c’est à plusieurs vitesses. Il faut que, vous voyez, il y ait un accompagnement, un film tout seul comme ça, lâché dans la nature aucune chance en salle de survivre parce qu’il y a la concurrence des films de patrimoine qui vont sortir la semaine d’après et puis il y a surtout pas assez de places déjà pour les films frais donc c’est très compliqué de sortir des films de patrimoine.
Marina GRAESEL – Hormis l’ADRC, sur les plans de communication, ils sont réalisés par l’ayant droit du coup … ?
Béatrice DE PASTRE – Si, l’ayant droit fait sa communication, et il faut qu’il la fasse. Il faut qu’il y ait alors justement des choses qui ont fonctionnées : pour Le Joli Mai y a une affiche qui a été réédité y a eu vraiment pas mal de presse, y a eu une attachée de presse qui a été embauchée par l’ayant droit pour la sortie du film ce qui a bien marché aussi, c’est le Clouzot, ou vous avez, euh, bah l’exposition de la cinémathèque française a ressorti, a remis sur le marché une dizaine de films, un ouvrage, une rétrospective ADRC et ça a permis de parler de Clouzot pendant 2 ans, entre la sortie de la présentation des premiers films au Festival Lumières, l’inauguration de l’exposition à la cinémathèque française qui a duré toute une saison, dans la salle des donateurs, le livre de Noël Herpe voilà le package de l’ADRC et tout ça, ça fait que y a de la presse et qu’on peut renvoyer les spectateurs vers tel document et ca avait été coordonné par Ghislaine Gracieux qui c’est spécialisée justement dans l’accompagnement des ayants droits, mais en plus ce qui été compliqué c’est que le catalogue Clouzot il est chez plusieurs ayants droits. Vous avez des films chez Studio Canal, vous en avez d’autres chez Madame Clouzot et voilà. Chez TF1 et donc elle, elle a œuvré pour l’ensemble et vous aviez un interlocuteur et c’est elle qui s’est occupée de l’ensemble, ce qui est plutôt bien, chacun, si vous voulez, pouvait s’occuper de son propre film avec son distributeur, mais elle permettait d’avoir une entrée unique sur ces films restaurés. Ça a bien marché. Ça a permis de redécouvrir certains films oubliés, à cette occasion.
Marina GRAESEL – Et au niveau du droit, est ce qu’il existe des lois qui régissent la restauration ?
Béatrice DE PASTRE – Non, y a pas de lois. Y a un encadrement éthique où chacun dit un peu ce qu’il veut, donc c’est pas la même chose en fonction, voilà. Alors c’est quand même plus de la déontologie que de l’éthique, voilà. Nous on est attachés à restituer l’œuvre telle que le spectateur l’a découvert en salle quand il est sorti la première fois. Pour beaucoup d’ayants droits, de réalisateurs encore vivant, c’est l’occasion d’arranger voilà le film. À en revoir un bout de montage, à faire des trucs qu’ils n’ont pas pu faire pendant que le film a été fait initialement. Nous ont est plutôt opposé à faire ce genre de choses. On se heurte aux droits d’auteur par exemple ca a été le cas sur Le Joli Mai où lorsqu’on avait fait la première restauration du film, en 2009, Chris Marker avait demandé la suppression d’une séquence de 14 minutes. Alors Chris Marker est mort, le film a été restauré en numérique sous la supervision de l’autre auteur du film, Pierre Lhomme, qui a voulu enlever encore 7 minutes du film. Donc là on a discuté, minute à minute, séquence par séquence, voilà et on est arrivé à une coupe de 4 minutes et quelques, sur laquelle il ne voulait pas céder. Et c’est une question vraiment problématique, j’ai lu récemment une interview de Rappeneau, qui suite à la restauration financé par le CNC de Cyrano de Bergerac on lui dit : « Et pour vous, quel est l’intérêt de restaurer vos films ? » et il dit « Pour revoir le montage », c’est pas fait pour ça une restauration. Donc ça, c’est très compliqué. Parce que, en France effectivement, c’est l’auteur qui prime, et nous on ne donne pas, parce que c’est de l’argent public, qui ne doit pas servir à corriger les erreurs du passé, si erreur il y a… Alors y a pas d’erreur, c’est un film que des millions de gens ont, c’est le cas pour Cyrano de Bergerac, ont vu le film, alors pourquoi le changer et le mettre aux goûts du jour. C’est assez compliqué de ce côté-là. Alors effectivement il y a tous les problèmes liés à la technique, qui relève aussi d’une déontologie de la restauration je pense que ça va être l’objet d’une prochaine question… ?
Marina GRAESEL – Oui… Mais vous nous avez dit qu’en France c’est le droit d’auteur qui primait, mais les autres pays c’est… ?
Béatrice DE PASTRE – Aux États-Unis, c’est le « Final Cut » n’est pas au niveau du réalisateur, du monteur, mais du producteur, c’est le producteur qui sans demander son avis au réalisateur fait la restauration. En France c’est l’ayant droit le producteur, mais qui doit tenir compte de l’avis des auteurs. Et là pour Le Joli Mai, il s’est avéré que c’était le cas, c’était le producteur, et en tant que producteur avait confié la supervision de la restauration à l’un des deux auteurs.
Charlotte DA CUNHA – Et là dans le cas où les auteurs du film sont décédés, et qu’il n’y aurait pas de descendance, par exemple, là un producteur qui aurait les droits, il pourrait lui aussi choisir vraiment … ?
Béatrice DE PASTRE – Il peut aussi.
Charlotte DA CUNHA – D’accord.
Béatrice DE PASTRE – Mais en général, il ne le fait pas. Je n’ai pas d’exemple où là un producteur au moment de la restauration, aurait nettoyé, modernisé, parce que c’est vraiment plus une démarche effectivement d’auteur, d’auteur vivant, ou de l’ayant droit. Ca nous est arrivé par exemple, bon ça ce n’était pas en numérique, mais la question aurait été la même, avec les ayants droits Prévert, Pierre et Jacques, qui voulaient qu’on restaure un film selon un scénario.
Charlotte DA CUNHA & Marina GRAESEL – Oui.
Béatrice DE PASTRE – Alors qu’il y avait eu un tournage, un montage et que Pierre Prévert lui-même était revenu sur le film et l’avait remonté en 1955, et non, ça n’allait pas non plus, il fallait revenir au scénario. En sachant que ce n’est pas parce que c’est écrit dans le scénario que ça a été tourné et que ça a été monté. Donc voilà, ça a été très compliqué « de négocier » et on n’a pas fait la restauration de ce film là.
Charlotte DA CUNHA – C’est surtout que cela demanderait un travail supplémentaire, ça demanderait de chercher des bouts de séquences, ce qui est peut être pas forcément dans le film… ?
Béatrice DE PASTRE – Oui c’est ça justement, la on leur a prouvé que l’on n’avait pas « la matière à… ». De un, on ne voulait pas le faire, et de deux y avait pas matière, c’était des séquences qui n’avaient pas été tournées.
Charlotte DA CUNHA – Effectivement c’est problématique…
Béatrice DE PASTRE – Tout un ensemble de paramètres qui arrivent là, et c’est vrai que se placer du point de vue de l’histoire du cinéma, en disant « Voilà c’est tel film qui est sorti en salle, c’est ça que le spectateur a vu et historiquement. » Voilà c’est ça qui doit être pris en compte, ça permet d’échapper à priori un peu à ça. Après il peut y avoir débat sur « Oui mais le producteur a exigé que… », dans ces cas là, on restaure en plus les séquences en question, pour aller en bonus où on peut insérer aussi dans le film, une deuxième version du film. Mais ce qu’il faut, c’est que le film tel qu’il a été vu par les spectateurs au moment de la sortie soit disponible. Soit visible par les spectateurs.
Charlotte DA CUNHA – Est-ce que c’est automatique quand on demande restauration, qu’il y ait une sauvegarde sur un autre support, par exemple ?
Béatrice DE PASTRE – Alors dans le cadre de cette aide, on a demandé à ce qu’il y ait un « retour sur film ». De la restauration, donc c’est-à-dire à la création d’un nouveau négatif sur 35 millimètres pour assurer la pérennité de cette restauration. On a un autre dispositif qui s’appelle « le N.O.U.M.V. » qui a été mis en place après le dispositif de 2012. Je pense en 2015, où là, si vous voulez, on n’exige pas ce « retour sur film », mais là c’est plus une aide à la numérisation, c’est-à-dire pour des films plus récents, où là on va numériser le négatif faire un petit ré-étalonnage ou enlever les poussières automatiquement etc… là où il ya très peu d’interventions à la tablette graphique et où ne se pose pas des tas de question : « Quel est le bon négatif ? Quel est le… voilà » des choses assez simples et ce qui permet, qui permettent en général aux ayants droits de faire des coffrets blu-ray, de les mettre sur des plateformes, ce n’est pas forcément des films qui vont ressortir en salle. Et là, c’est des films pour lesquelles le matériel d’origine en général, c’est des films qui ont été réalisés entre 1980 et 2000, ne nécessitent pas, si on veut ,le film matériel est en bon état, il n’est pas atteint par le syndrome du vinaigre, il n’est pas totalement dégénéré au niveau des couleurs. Ça ne justifie pas un « retour sur pellicule » qui est quand même coûteux. Mais qui assure la pérennité du film, et si le matériel original est en bon état, y a pas de raison pour se surajouter cette dépense.
Charlotte DA CUNHA – Et justement, la restauration, est-ce que c’est presque exclusivement réservé pour les films de patrimoine, ou il y a beaucoup de films « modernes », plus dans nos temps ?
Béatrice DE PASTRE – Nous dans nos dispositifs, on prend en compte les films tournés jusqu’au 31 décembre 1999. Le patrimoine, pour nous, s’arrête là. Alors il y a eu une extension de cet encadrement pour les court-métrages, qui ont été tournés entre 2000 et 2006. Qui ont été tournés sur pellicule et qui nécessite du matériel numérique pour continuer à être exploité. Donc on a fait une extension pour les court-métrages, je pense que l’on va jusqu’au 31 décembre 2006, mais on n’en a pas eu beaucoup. L’agence de court-métrage nous en a proposé certains, mais finalement assez peu.
Charlotte DA CUNHA – D’accord. On a dit qu’il n’y avait pas de lois qui régissent tout ça, il n’y a pas de sanctions qui peuvent être engagées alors ? Pas de sanctions du tout ?
Béatrice DE PASTRE – Non pas de sanctions. Nous on va, si vous voulez, alors sur justement, sur le plan numérisation, on va contrôler le « retour sur film » justement. Cet élément 35 millimètres, on va veiller à ce que, cet élément 35 millimètres respecte le cadre d’origine. On ait effectivement, en cas de retirage de copie, on ait vraiment la totalité de l’image, au bon format. Parce qu’il y a parfois des formats divers et variés, et on veille, et là on ne paye pas tant que le « retour sur film » n’est pas correct. Alors ça, c’est une sorte de sanction, mais effectivement ce n’est pas, si vous voulez, à partir du moment où il n’y a pas de lois, vous ne pouvez pas être sanctionné. Donc il n’y a pas de lois sur la restauration, ce qui reste quelque chose de très subjectif et lié aux goûts également. Je pense qu’il y a un primat du neuf et du propre, qui est une mode qui va très certainement passer. Déjà certains ayants droits ont fait machine arrière en se rendant compte que ça donnait des images absolument irregardables, tellement c’est froid, métallique. Surtout sur le noir et blanc, en restaurant en numérique, c’est une catastrophe, c’est des films qui perdent tout leur charme à force d’avoir été restauré numériquement. Je pense que ça, c’est un effet de mode, et bon vivement que la mode passe quoi.
Marina GRAESEL – Et en terme de déontologie du coup, comment ça s’organise ?
Béatrice DE PASTRE – Alors nous on a une idée, on a une charte un peu de déontologie, si vous voulez, nous la restauration ça va être toujours dans cette idée de restituer le film tel qu’il a été au moment de sa sortie, c’est-à-dire que la restauration va consister à supprimer tout ce que le temps a amené sur le film : déchirures, rayures, poussières… On va s’attacher à restituer les couleurs, les teintages quand c’est le cas, tels qu’ils étaient pratiqués à la sortie du film, à condition que l’on n’ait, soit des indications de teintage sur le négatif, soit qu’on ait une copie qui serve d’étalon. Si l’on n’a pas ça, on ne va pas s’amuser à faire des teintages voilà. Le film restera en noir et blanc, même si on sait que le film a été exploité en couleurs, on ne fera pas de teintage à partir du moment où l’on ne sait pas où est-ce que l’on met le bleu, où est-ce que l’on met le vert, où est-ce que l’on met le sépia. Voilà, grosso modo c’est ça, mais c’est déjà assez compliqué à suivre, si vous voulez, et à faire respecter aussi. Savoir jusqu’où effectivement on va aller, on va restaurer, ça c’est aussi est-ce que on va enlever le moindre petit point blanc sur l’image, etc… ? Bon nous on n’est pas partisan de ça, étant donné qu’effectivement on arrive après à des choses tellement restaurées que l’on va avoir des artefacts numériques qui vont apparaître. Quand vous avez certaines rayures qui sont tellement profondes, qui si on la restaure « complètement », vous allez avoir une bande flou dans l’image. Donc il vaut mieux avoir une rayure, plutôt que quelque chose qui va bouger, où en fait l’œil ne va pas comprendre ce qu’il se passe. Les rayures, on comprend ce que c’est, l’œil comprend, même pour des jeunes générations, voilà, les trois premières ça va surprendre mais après y a pas de problème. Mais là si vous voulez, le plus dérangeant c’est d’avoir des amas de pixels qui vont réseauter dans un coin, alors on essaye impérativement d’éviter ce genre de choses pour avoir quelque chose d’aussi agréable à l’œil du spectateur, de l’historien et de l‘auteur, si jamais l’auteur est encore là.
Charlotte DA CUNHA – Est-ce que vous faites d’autres restaurations que des restaurations numériques ?
Béatrice DE PASTRE – Oui on fait encore des restaurations argentiques pour certains films, c’est-à-dire que l’on va passer le film dans une tireuse et faire effectivement un négatif, un contretype ou un interpositif en argentique oui.
Charlotte DA CUNHA – Et pourquoi on choisit plutôt du numérique que de l’argentique ?
Béatrice DE PASTRE – Alors le numérique aujourd’hui permet l’intervention sur l’image en quelques sortes, on a des fonds, par exemple on a un fond qui vient de l’ancêtre du CNRS, l’ONRSI, qui était une agence, enfin une institution qui témoignait par le cinéma de toutes les inventions qui étaient testées dans ce centre. Et qui se servait, si vous voulez, on a le cinéma qui enregistre une technologie qui est un peu, pour le passé, en banc d’essai, pour pouvoir se projeter et tester si c’est concluant. Par exemple, c’est un organisme créé en 1915, pour l’armement de guerre, pour tout le matériel pendant la Première Guerre Mondiale. Donc on a filmé comme cela, des essais d’appareils, alors ca peut être des canons, ca peut être des cisailles de barbelés, ca peut être des casques, voilà, du matériel de guerre, qui a été testé si vous voulez, le cinéma va enregistrer des essais et on va se servir du cinéma pour vérifier la pertinence de tel ou tel matériel. Mais c’est aussi la promotion de ces inventions, par exemple à propos de casques, on a un casque, c’est le casque Adrian qui a été choisi par l’armée française, mais a été développé aussi le casque du Docteur Pollock, et on a vraiment le banc d’essai du casque. C’est-à-dire qu’on lui met des coups de baïonnettes, on lui tire dessus à bout portant, enfin voilà on a, si vous voulez, le film sert de promotion en quelques sortes, de publicité voilà. Donc l’ONRSI, si vous voulez, y a certains films effectivement où il y a certains négatifs où il y a des tirages de copies, mais d’autres qui sont neufs. Et donc là, on fait une sauvegarde effectivement argentique, on fabrique un nouveau négatif et éventuellement une copie. Donc c’est des négatifs, on a un élément interpositif, un nouveau négatif parce que c’était d’une trame, et puis on va numériser l’inter-négatif ou même directement un négatif pour avoir un fichier facilement exploitable mais on ne va pas faire de restauration numérique. Parce que cela ne sert à rien. Donc effectivement en fonction de l’état du matériel on va choisir telle ou telle filière et également en fonction de la valorisation qu’il va y avoir. Là, ses films là, si vous voulez, ils vont être mis en ligne sur le site du CNRS, pour un public de niche, on va ne pas faire de grandes projections. C’est des films tout à fait passionnants mais alors qui concernent des objets tout à fait diverses. Vous avez la première machine à laver la vaisselle au Salon des Arts Ménagers en 1924, qui est filmé en plus d’une façon très intelligente : l’appareil est désossé et c’est filmé en contre-plongée pour voir effectivement le mouvement des balais, c’est super ! Mais c’est aussi la cisaille à fil de fer barbelé, c’est les hangars gonflables… Alors ce qui est super avec les hangars gonflables, c’est que l’on se rend compte que toutes les structures dans les jeux pour enfant, etc… les trucs qui se gonflent, c’est ça ! Ca a été inventé à ce moment là. On arrive à faire une histoire de certains matériels grâce à ce film, ça a tout à fait un intérêt à être sauvegardé et fini, qui ne doivent pas disparaître. Mais ce n’est pas pour autant si vous voulez, qu’on va faire une numérisation 4K et passer je ne sais pas combien de temps, d’ailleurs y aurait pas de temps à faire en restauration parce que l’image est neuve. Donc on ne le fait pas, et ce n’est d’ailleurs pas des films qui nécessitent qu’il n’y ait pas un grain de poussière, etc….
Charlotte DA CUNHA – Donc pour « résumer », le plus souvent quand c’est des films qui vont être re-projetés et qui sont peut-être être un peu plus abîmés, on va plus se tourner vers le numérique, alors que si c’est des films neufs, et qui ont eu un public plutôt niche, c’est plus vers l’argentique que l’on va partir alors ?
Béatrice DE PASTRE – Voilà, mais on va quand même numériser le résultat de cette sauvegarde pour que ça soit disponible facilement en numérique. Ce qui nous commande toujours, c’est l’état du matériel d’origine, l’état du matériel dont on va se servir pour faire la restauration. En fonction de l’état de ce matériel, on va choisir telle ou telle filière. Après intervient aussi : pour quel public ?
Marina GRAESEL – Et une restauration, du coup argentique, va coûter à peu près combien ?
Béatrice DE PASTRE – Alors celle là on les fait en général en interne, donc c’est du coût « homme », du coût « machine », de la pellicule. Ca coûte moins cher, mais ça a un coût quand même parce que la pellicule aujourd’hui ça coûte très cher. C’est du temps aussi, c’est des produits chimiques, du développement, etc… Donc ce n’est pas sans coût, mais là aujourd’hui, j’aurais du mal à vous dire combien coûte un mètre de pellicule développée. En plus nous on est en train de réinstaller notre labo photochimique, on a réinstallé une développeuse noir et blanc neuve, une développeuse couleur neuve, donc ça fait à peu près deux ans qu’on n’a pas tourné nous en argentique. Je vais avoir du mal à vous dire combien on paye la copie chez Kodak actuellement.
Charlotte DA CUNHA – Est-ce que vous avez une idée, parce que du coup vous faite de la restauration, mais y a des labos aussi privés du coup qui s’en occupent, et …
Béatrice DE PASTRE – Avec lesquels on travaille aussi parce que même pour notre production interne, sur nos collections, on travaille aussi avec des laboratoires extérieurs.
Charlotte DA CUNHA – …Et les laboratoires en question, est ce que c’est un peu le même fonctionnement que vous ou pas ? Dans le sens où un ayant droit peut venir directement voir un labo, sans passer par le CNC, et du coup est ce que les labos ont une démarche « éthique » comme la vôtre ?
Béatrice DE PASTRE – Alors ils disent tous qu’ils ont une éthique de restauration, après là, le rapport est entre client et …
Charlotte DA CUNHA – Oui c’est vraiment…
Béatrice DE PASTRE – …Donc a priori, ils font ce que le client leur demande de faire. Et s’ils ne le font pas, il n’y aura pas de prochaine fois. Mais y en a qui discutent en disant : « Bah est ce que vous pensez, vu la date de réalisation du film, c’est nécessaire de faire tel ou tel processus, etc ? ». Y en a qui mènent cette démarche, mais au final, c’est le client qui a le « final cut » là aussi.
Charlotte DA CUNHA – Donc au final, les labos, c’est peut être un peu moins une démarche « déontologique », enfin sans grossir le trait, c’est plus vraiment…
Béatrice DE PASTRE – Ils font ce que l’ayant droit leur demande.
Charlotte DA CUNHA – C’est commercial…
Béatrice DE PASTRE – Oui, oui c’est une démarche commerciale. C’est tels enjeux… mais aussi nous faut dire que l’on n’a pas gain de cause à chaque fois. Y a quelques exemples où effectivement…
Marina GRAESEL – Et pour quels projets vous faites appel aux labos privés ?
Béatrice DE PASTRE – Oui on a des marchés avec les labos privés, parce qu’on ne peut pas tout absorber, dans notre travail qu’on a décidé de faire, donc on passe effectivement par des labos privés.
Charlotte DA CUNHA – Et sans rentrer dans le détail, comment vous choisissez justement ses labos ? C’est des compétences… ?
Béatrice DE PASTRE – Alors c’est un processus de marché public, on a plusieurs attributaires maintenant par lots : on a un lot de restauration argentique, un lot de restauration numérique, un lot de restauration son et un lot de numérisation juste pour avoir des fichiers numériques sans qu’il y ait forcément de restauration. Et on a un lot de réparation du support d’origine, parce qu’il y a parfois des réparations très très longues à faire et si on les fait ici, ça occupe un chargé de restauration, à temps plein pendant six mois, donc on ne peut pas se le permettre, vue la charge de travail que l’on a. Il y a un laboratoire qui est dédié à cela, qui a fait si vous voulez, de son cœur de métier, ces réparations de supports, donc ça c’est pour le lot 1 parce que le lot 1 c’est la réparation. Après on a quatre souvent attributaires de chacun des marchés. C’est des démarches très compliquées les marchés publics, mais nous on leur fait faire des tests. On donne à chaque laboratoire qui candidate sur l’un de nos marchés, un test à faire et on juge des résultats, et si vous voulez, on prend les quatre meilleurs pondérés par le coût, leur cahier de prix si vous voulez. Donc la note qualitative plus la note économique, ça donne une moyenne, et on va prendre les quatre meilleurs.
Marina GRAESEL – Et au niveau des logiciels qui sont utilisés, comment ça se passe au CNC ?
Béatrice DE PASTRE – Alors, bah écoutez, ici on a un logiciel, Diamant et aussi Phoenix, deux logiciels qu’on utilise pour la restauration. Et on utilise Resolve, pour l’étalonnage. Après ça c’est mes collègues maintenant du laboratoire, qui… Bon Diamant on l’a depuis très longtemps, c’est le logiciel qu’il y a ici de restauration depuis 2004, qui est une filière de restauration numérique. Et Phoenix on l’a acquis il y a deux ans à peu près, parce que Phoenix ne fait pas tout à fait les mêmes choses que Diamant, donc pour pouvoir optimiser au mieux notre intervention… et après ça Resolve, à priori, c’est même un logiciel qu’on utilise en postproduction pour les films frais. À priori, enfin en tout cas pour mes collègues, c’est le meilleur logiciel d’étalonnage.
Charlotte DA CUNHA – Alors pour la conclusion de notre entretien, c’est plus votre côté vous personnel, votre vision de tout ça. Est-ce que vous trouvez que la restauration numérique va plus dans le sens de la restauration et de la sauvegarde des films, ou est-ce que ça peut avoir des couacs ?
Béatrice DE PASTRE – Y en a oui bien sûr. Ce que je vous disais, y a un excès de restauration sur beaucoup de films qui font que, si vous voulez, quand vous voyez le film, y a rien qui indique que ce film a été réalisé en 1930, voilà. Et ça, ça peut devenir gênant dans l’inadéquation entre l’aspect « physique » et le mode de narration par exemple. On va se dire : « Mais comment on peut raconter une histoire comme ça, et faire des images… ? ». Il y a une sorte de distorsion en fait, et c’est très important pour ce qu’on transmet aux générations futurs, d’arriver à comprendre pourquoi un film il est ce qu’il est. Parce qu’un film, c’est la rencontre entre un individu, le réalisateur, l’auteur de scénario… on va dire un individu, un groupe créatif, on va dire, et une culture et une technologie. Et la restauration, c’est la rencontre aussi d’un restaurateur, avec sa culture et sa technologie. Il ne faut pas que ce groupe là vienne annihiler le travail qui a été fait par le premier groupe. Il faut que ce groupe là, restaurateur, culture du restaurateur et technologie du restaurateur, ne vienne pas contrefaire le travail du premier groupe créatif. Et ça, je pense que c’est la base de la restauration. À partir du moment où il y a ce respect du travail, de la culture et de la technologie qui a donné lieu à cette œuvre, la restauration est réussie. À partir du moment où vous fabriquez quelque chose qui devient incompréhensible, pour le spectateur, pour l’historien, alors là, c’est raté. C’est raté, c’est dangereux, parce que vous effacez toute possibilité de compréhension du film pour les générations à venir. Puisque le matériel d’origine il va quand même disparaître un jour ou l’autre. Donc voilà, nous on a encore la chance d’avoir effectivement des œuvres originales, on a encore quelques négatifs et copies de Méliès, des négatifs Lumière, il faut impérativement que les restaurations que l’on fait aujourd’hui et les éléments fabriqués au moment des restaurations puissent témoigner de « Qu’est-ce que c’était un film de George Méliès, qu’est-ce que c’était un film Lumière ? ». Autrement, on va interdire aux générations futures la compréhension de cet art et on aura tout raté.
Marina GRAESEL – Et est-ce que vous avez éventuellement d’autres exemples où une restauration a été particulièrement problématique ?
Béatrice DE PASTRE – Oui il y a des restaurations longues, difficiles, bon après nous on n’a pas eu d’exemples de restaurations qu’on a du arrêter.
Marina GRAESEL – Non, je veux dire en terme de relationnel.
Béatrice DE PASTRE – Oui on discute toujours, après y en a un qui doit céder. C’est plus souvent nous, parce qu’effectivement, nous ne sommes pas les auteurs ou les représentants des auteurs. Mais après, on n’a pas fait pleins de choses qui nous posent beaucoup de problème. Après, Le Joli Mai reste le film… voilà. Cyrano de Bergerac, je n’ai pas vu la restauration finie, je ne sais pas ce qu’à fait Jean-Paul Rappeneau…
Charlotte DA CUNHA – Merci beaucoup.
Marina GRAESEL – Merci beaucoup.
Béatrice DE PASTRE – Merci d’être venues jusqu’ici.
Marina GRAESEL – Avec plaisir.
Charlotte DA CUNHA – Au contraire.
Bibliographie
VIGNOUX Valérie, « Archives et Histoire : des archives pour l’histoire – du cinéma ? », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze, n°40, biannuel, p.107-119.
FIAF (Fédération Internationale des Archives du Film), Journal of Film Preservation, n°87, biannuel.
DUVAL Gilles et WEMAERE Séverine, La couleur retrouvée du Voyage dans la lune, Paris : Fondation Technicolor pour le Patrimoine du Cinéma & la Fondation Groupama Gan pour le Cinéma, 2011.
CNC (Centre National du Cinéma et de l’Image Animée), Aide à la numérisation des films de patrimoine Bilan 2012-2018, Paris : CNC, 2018.
BESSERER Bernard et BOUKIR Samia, « La restauration numérique des films cinématographiques », Dossiers de l’audiovisuel, n°110, bimestriel, p.38-43.
THONON Jonathan, « A perte de vue – Les archives cinématographiques à l’épreuve de la disparition », MethIS, n°2, annuel, p.133-152.
DENIOZOU Iris, « Restauration des films : le principe de la documentation et le rôle de la recherche », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze, n°83, biannuel, p.111-127.
CNC (Centre National du Cinéma et de l’Image Animée), Présentation du dispositif d’aide à la numérisation des films de patrimoine du CNC, Paris : CNC, 2014.
FRAPPAT Marie, « “Réactiver” les oeuvres – histoire et pratiques des professionnels de la restauration des films », L’Histoire à l’atelier. Restaurer les oeuvres d’art (XVIIIe-XXIe siècles), Presses universitaires de Lyon, 2012, p.181-201.
MILES Florian, Introduction à la restauration cinématographique, https://cannesclassics2017.wordpress.com/2017/05/26/introduction-a-la-restauration-cinematographique/, consulté le 20 octobre 2018.
PACAUD Florence, Les enjeux éthiques de la restauration cinématographique, https://www.franceculture.fr/cinema/les-enjeux-ethiques-de-la-restauration-cinematographique, consulté le 19 octobre 2018.
AFP (Agence France-Presse), La restauration des films, un travail d’orfèvre au service d’un marché en plein essor, https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/cinema-la-restauration-des-films-un-travail-d-orfevre-au-service-d-un-marche-en-plein-essor_1841362.html, consulté le 23 octobre 2018.
FROIS Emmanuèle et BOMMELAER Claire, Une seconde vie pour les classiques du 7e art, http://www.lefigaro.fr/cinema/2012/11/29/03002-20121129ARTFIG00370-une-seconde-vie-pour-les-classiques-du-7eart.php, consulté le 5 novembre 2018.
CELLULOID ANGELS, Comment participer ?, https://www.celluloid-angels.com/page/mode-demploi, consulté le 17 novembre 2018.
CHAMBAH Majed, Analyse et traitement de données chromatiques d’images numérisées à haute résolution : application à la restauration numérique des couleurs des films cinématographiques, https://www.theses.fr/2001LAROS081, consulté le 6 novembre 2018.
PACAUD Florence, Les enjeux éthiques de la restauration cinématographique, https://www-franceculture-fr.cdn.ampproject.org/v/s/www.franceculture.fr/amp/cinema/les-enjeux-ethiques-de-la-restauration-cinematographique?amp_js_v=a2&_gsa=1&usqp=mq331AQECAFYAQ%3D%3D#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Source%C2%A0%3A%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.franceculture.fr%2Fcinema%2Fles-enjeux-ethiques-de-la-restauration-cinematographique, consulté le 23 novembre 2018.
KOERBER Martin, La restauration de films avec les outils de post-production numérique, https://www.canal-u.tv/video/cinematheque_francaise/la_restauration_de_films_avec_les_outils_de_post_production_numerique_martin_koerber.7796, consulté le 18 novembre 2018.
DREYFUS Stéphane, Le numérique offre une nouvelle vie au patrimoine cinématographique, https://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Sciences/Le-numerique-offre-une-nouvelle-vie-au-patrimoine-cinematographique-_NP_-2012-01-02-753136, consulté le 15 novembre 2018.
SCHWARTZ Arnaud, La fragile mémoire du cinéma numérique, https://www.la-croix.com/Ethique/Sciences-Ethique/Sciences/La-fragile-memoire-du-cinema-numerique-_NG_-2012-01-02-753133, consulté le 15 novembre 2018.
CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée), Aide sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/patrimoine-cinematographique/aide-selective-a-la-numerisation-des-oeuvres-cinematographiques-du-patrimoine_190901, consulté le 5 janvier 2019.
BILLAUT Manon, Compte-rendu de la projection / rencontre « La restauration des films à l’ère du numérique », https://afrhc.fr/compte-rendu-de-la-projection-rencontre-la-restauration-des-films-a-lere-du-numerique/, consulté le 7 décembre 2018.
PACAUD Florence, Visite d’un laboratoire de restauration, https://www.franceculture.fr/cinema/visite-dun-laboratoire-de-restauration, consulté le 23 novembre 2018.
La Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation de l’Audiovisuel, La restauration de films, besoin d’une formation ?, http://www.cpnef-av.fr/les-etudes/la-restauration-de-films-besoin-, consulté le 5 janvier 2019.
FABRE Clarisse, La numérisation des films, inventaire et grand chantier, https://www.lemonde.fr/cinema/article/2011/05/31/la-numerisation-des-films-inventaire-et-grand-chantier_1529988_3476.html, consulté le 5 janvier 2019.
KIRCHHARTZ Andrea, Produit – détruit – reconstruit : l’histoire de Metropolis et de sa restauration, p.31, https://www.persee.fr/doc/1895_0769-0959_1995_num_19_1_1134, consulté le 5 janvier 2019.
KIRCHHARTZ Andrea, Problèmes éthiques et méthodologiques dans la restauration numérique, http://www.cinematheque.fr/video/811.html, consulté le 10 janvier 2019.
BERRIATÚA Luciano, Comment le cinéma est devenu un art en France (1/4), http://criticamasonica.over-blog.com/2018/01/comment-le-cinema-est-devenu-un-art-en-france-1/4.html, consulté le 25 janvier 2019.
Wikipédia, Cinéma, https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma, consulté le 15 octobre 2018.
Wikipédia, Louis Delluc, https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Delluc, consulté le 15 octobre 2018.
Lintern@ute, Cinématographe, https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/cinematographe/, consulté le 22 octobre 2018.
Wikipédia, Henri Langlois, https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Langlois, consulté le 25 octobre 2018.
Larousse, Philologie, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/philologie/60259, consulté le 12 novembre 2018.
ROIG Eric, Ayant droit, https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/4010-ayant-droit-definition, consulté le 12 novembre 2018.
Larousse, Contretype, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/contretype/18903, consulté le 12 novembre 2018.
Image issue de Digicolor Studio : http://www.digicolorstudio.be/restauration-numerique-films-cinema/
Lintern@ute, Collure, https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/collure/, consulté le 25 octobre 2018.

